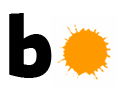



Tous mes emmerdes ont commencé après le Mondial 98. Ils ont un lieu : les Balkans, prélude à un calvaire parisien sans fin où j’ai perdu honneur, dignité et santé.
Le Joueur avait joué pendant le Mondial et s’était brillamment distingué. Je l’avais adoré. Pour son jeu, ses prouesses et l’espoir qu’il libérât la France des couleurs, pour l’utopie devenue réalité, le ciment qu’il incarnait entre tous les Français.
Le Mondial est passé. La guerre a commencé. Milosevic faisait commettre ses horreurs d’épuration ethnique, les Américains, l’OTAN et les forces alliées libérèrent et protégèrent le Kosovo. Après avoir couvert de nombreuses guerres, et il y avait peu les dix premiers jours de bombardement de Grozny en Tchétchénie, je pensais toujours avoir la légitimité pour aller voir ce qui se passait dans cette zone calme et sécurisée. Au journal, on était sur la force : la direction de la rédaction mettait en place un vaste dispositif de reporters sur le territoire kosovar. Je n’y figurais pas. Des confrères sans aucune expérience m’étaient préférés. Ils allaient rejoindre d’autres plus aguerris. Je me dis : tiens, c’est bizarre, la roue tourne. Je dois m’habituer à cette nouvelle sensation, cette nouvelle vie, je dois sans doute commencer à l’inventer. En même temps, je ne pouvais m’empêcher de penser que c’était du gâchis : je savais faire le reporter dans les circonstances difficiles, j’aimais ça et c’était une démarche où on ne cesse de se bonifier. Je maîtrisais mieux les problèmes de logistique, je savais mieux approfondir les problématiques, travailler l’écoute dans le recueil des témoignages, chercher l’essentiel et cultiver le sens du détail, écrire une « histoire », bâtir un récit, faire le miroir sensible comme l’on nous le demandait.
J’étais amer, lucide, éprouvais un sentiment d’injustice que je voulais réprimer. Nous faisions partie d’une équipe, l’intérêt du journal était de former des nouveaux, j’avais une mission intéressante bien que plus périphérique : aller à Sarajevo, raconter comment cette ville libérée depuis plusieurs années voyait et vivait cette mission des alliés. Je trouvais que ce décalage était intelligent. Je faisais partie de « l’équipe B », c’était comme ça. Evidemment qu’on avait envie d’être là où ça se passait, d’être dans la première des intensités. On vous avait appris à vivre comme cela, à conformer toute son existence à cela. Je devais rapidement faire le deuil de ce formatage et essayer de comprendre le nouvel usage de mes compétences car j’étais confronté à une sorte de salmigondis de non-dits et de gêne.
J’avais anormalement mal à un genou. Il était tout rouge. Mon médecin ne trouva rien à redire et me confirma que je pouvais partir. Je partis pour la Slovénie et pris une voiture pour rejoindre Sarajevo. La route était impressionnante par ses blessures, ses maisons brûlées, bombardées, ses villages sans vie, une atmosphère qui pouvait faire croire que la guerre était encore en train de se faire. Je réalisai un nouveau sentiment : la panique. J’avais peur de ne pas suivre la bonne route, m’arrêtai à chaque bourgade pour vérifier deux fois que j’empruntais la bonne direction. Je ne pouvais m’empêcher de penser que j’avais perdu la confiance du journal, et cela me fit perdre toute assurance. Allais-je bien faire ? Etais-je toujours capable travailler ? J’étais déjà allé à Sarajevo sous les bombes pendant deux réveillons. Ce retour ne signait-il pas une période où les vieux reportages seraient désormais des souvenirs, moi qui croyais sans cesse évoluer, n’allaient-ils pas me convaincre que j’étais désormais fini. « La roue tourne » me disais-je. J’étais vraiment fait pour continuer ce métier et non pas moisir dans la nostalgie, enragé de ne pas aller encore plus loin dans ce qui était mon sport, mon art et mon indéfectible sens à mon existence : perfectionner la sensibilité, la révolte retenue, l’ampleur du témoignage, la bouffée d’humanité, matière à se sentir lié, à apprendre, à penser, à rester debout en réalisant que ceux que je rencontrais et écoutais étaient aussi debout, espérant recouvrer paix, dignité et liberté.
Je me sentais amputé, j’avais mal au genou. Un pacte s’était brisé entre le journal et moi, entre moi et moi, j’avais perdu ma grandeur, pas celle de la frime mais celle d’être en situation d’être passeur entre les hommes, des endroits les plus stratégiques et tumultueux aux rues tranquilles de kiosques à journaux. Ma vocation était étouffée. Je devenais « l’écarté ». Ma vie se fracassait à Sarajevo où tout était bien calme.
Je grelottais, j’avais de la fièvre, avais de plus en plus de mal à marcher. Je tombai sur une famille de réfugiés albanais du Kosovo qui avait fui leur ville Pecz. Ils me racontèrent. J’étais heureux de renouer finalement avec l’événement. Je multipliais les lieux d’immersion, recueillant les mêmes paroles de dégoût et de désillusion face au spectacle du pouvoir aux mains des maffieux et d’anciens seigneurs de guerre.
Des habitants d’une cité de HLM, durement attaquée pendant la guerre, se terraient tous les jours dans les caves pour jouer aux cartes. Ils n’avaient pas de travail, pas d’espoir. Ils voulaient se nicher.
J’allai à l’hôpital psychiatrique où un nombre significatif de survivants étaient enfermés. J’aperçus des ombres d’hommes déambuler lentement dans un couloir. Je restais scotché : pendant quelques minutes, je m’identifiai à eux, me dit : quelle souffrance…
Je retournai à Zagreb, ma douleur au genou et ma fièvre en constante augmentation. Par l’entremise d’une traductrice, le médecin du parlement croate me consulta et m’ordonna de ne pas quitter le lit de l’hôtel pendant quinze jours, le temps qu’un traitement de cheval fasse son effet. J’avais été contaminé d’un érycipel, une infection du sang qui provoque un arrêt cardiaque. Le visage du médecin laissa trahir sa peur et un reproche d’inconscience à mon égard. Ce fut la fin de ma première mission d’un autre type, le début d’un nouveau regard que l’on porta sur moi.

