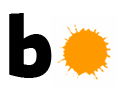



Finalement, on m’envoya au Kosovo, six semaines plus tard : le principal avait été écrit, le pays s’installait dans la routine. Je fis la route avec une vieille consoeur depuis le Monténégro qui m’avait troublé lors du dîner la veille où chacun raconta son passé, elle ancienne mao, moi ayant reçu une certaine initiation situationniste. Elle me lâcha très sûre d’elle :
![]() On sait les manipuler les mecs comme toi.
On sait les manipuler les mecs comme toi.
Mon assurance s’était déjà lézardée à Sarajevo. Je ne la questionnai pas. Nous nous séparâmes à la hauteur de Pecz. J’échouai dans une bourgade où étaient installés tous les journalistes. Je rejoignis l’une d’elle, collègue d’un ancien journal, et me surpris à lui dire :
![]() Je crois que je démarre une dépression.
Je crois que je démarre une dépression.
Elle lâcha un « c’est pas vrai » comme quelqu’un qui ne voulait plus rien entendre. Elle me brancha sur un photographe en partance qui lâchait son traducteur. J’embauchai celui-ci, un bellâtre qui avait travaillé en Suisse, répétait qu’il ferait n’importe quoi pour de l’argent, me séduisait légèrement, répondait à mon trouble sur un terrain que je devinais dangereux et m’obligeais à faire des crochets à la terrasse d’une pâtisserie où j’étais sommé d’attendre tandis qu’il était en tractation avec des hommes ressemblant à des maffieux, laissant traîner sur ma personne des regards pas vraiment rassurants. L’idée était de s’installer dans un village victime d’un massacre afin d’établir sa reconstitution et d’écrire la chronique des jours d’après. C’était un projet de page « Horizon » réalisée avec un photographe, un vrai copain. Nous allions tous les jours rejoindre le témoin principal. Il nous fit rencontrer les survivants. Les mémoires étaient vives, le trauma planait au dessus des maisons. Chacun apportait sa pierre au récit du génocide.
L’esprit d’une page « Horizon » était d’offrir un sujet magazine au lecteur, de prendre du temps, d’aller en profondeur, de s’affranchir des nécessités de rapidité, d’instantanéité, de livrer une vision décalée. Nous allâmes sept jours d’affilée au village. C’était bizarre, j’étais inhabituellement fatigué. Je prenais soin pourtant de bien dormir mais j’avais l’impression d’être dans un état second. Je n’en connaissais pas les raisons.
Un premier incident m’alerta. Le principal témoin nous montra la fosse à automobiles où son père avait été abattu puis nous montâmes à bord de sa camionnette. Il était ému. Je me surpris à laisser éclater un petit rire, comme pris par un mouvement d’humeur qui me dépassait. Sa cause idiote était la beauté de cet homme. J’étais assis à côté d’un homme beau et un rire fusa. Immédiatement, je m’excusai à voix basse, avais le sentiment d’avoir été traversé par la force de la bêtise, plutôt dépassé par une force étrange qui m’avait déconnecté de la réalité : un peu comme on prend de l’ecstazy. Je m’en enquis auprès de mon ami photographe. Il convenait que le décalage était gênant. J’étais terrassé par la honte. Une nouvelle fois, la confiance se lézarda, moi qui d’habitude savait et aimait écouter, accompagner, ressentir l’empathie, avoir, je crois, le ton juste.
Un autre événement me fit littéralement imploser. Avant mon départ, j’avais été interviewé sur mon itinéraire sur France-Inter. J’y racontais notamment l’exode kurde dans les montagnes iraniennes. A ma demande, l’attachée de presse du journal m’appela et me diffusa le contenu de l’interview retenue pour la diffusion. Une image me choqua. J’évoquais un père marchant dans la boue et tenant sa petite fille de deux ans, morte, les bras et les jambes raides. J’eus peur. Je pensais que cette image pouvait donner du plaisir à des auditeurs pédophiles, que moi-même, à ne retenir que ce tableau, je pouvais exprimer de la complaisance avec cette scène. Dès cet instant, tout s’emballa. N’avais-je pas peut-être en moi-même, au plus enfoui, un inconscient de meurtrier de petites filles ? Je m’horrifiais. Je me défigurais. Je m’envahissais de mon propre procès qui ne reposait sur rien mais se nourrissait, en s’emballant, du risque d’être un monstre caché, un monstre dont je serais incapable de soupçonner l’existence mais qui se révélerait peut-être. Il fallait que je me répéte que je n’étais pas pédophile, j’en étais certain, mais c’était horrible, un public allait peut-être me soupçonner de l’être, j’étais bon pour être pris dans une spirale kafkaïenne, soumis à un délire dont je découvrais la nouveauté et l’ampleur. Avec le recul, quelque chose me dit qu’un poison m’avait été administré pour que ces dérèglements se déclenchèrent, que l’immense fatigue ne me quittât pas.
Tout était étrange dans ce reportage. Je mis une semaine à écrire cette page. Le journal me répondit que tout réfléchi, il ne la publierait pas : on avait trop lu ici et là des récits de massacres. Je défendis la spécificité de mon travail mais j’étais tellement surpris d’un tel refus, c’était le premier de ma carrière.
Le traducteur et le chauffeur s’arrêtèrent un jour en pleine campagne prêts à saisir une arme et prêts, je le sentais, à un enlèvement, se ravisant après un sérieux coup de gueule. Le traducteur insista ensuite avec douceur pour passer quelques jours de vacances avec moi en Macédoine. Devant mon refus, il voulut sans succès m’accompagner jusqu’à la frontière. En Macédoine, je me retrouvai seul à l’aéroport. J’avais l’expérience des flics, j’avais couvert la rubrique « Police » pour Libération et Le Monde. Là ça en était truffé et ils me regardaient quand je ne les observais plus. Policiers et agents secrets, sans nul doute.
J’arrivai à Paris avec un échec et un délire qui m’inquiétèrent. J’étais déchu. Tous les indices s’accumulaient pour que moi le grand reporter apprécié et suremployé devait passer la main à l’âge de 38 ans. Et dire qu’un an auparavant, j’écrivais sur la France des supporters, une nation qui se découvrait amicale et unie dans sa diversité, célébrait l’épopée des tricolores du Mondial et admirais le Joueur en faisant comme tous les Français : en lui ouvrant mon cœur.

