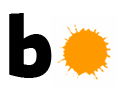



Je n’arrêtais pas de penser à une jeune femme de concierge de la cité de la Muraille de Chine aujourd’hui à Saint-Etienne. Je l’avais rencontrée en reportage par hasard. C’était une petite grosse, toujours prête à rire et à montrer qu’elle ne reculerait devant rien pour assurer un avenir à ses enfants. Elle avait la rage, la bonne humeur, racontait autant la souffrance que la solidarité dans sa cité. Son mari, d’origine algérienne, était un homme doux, toujours disponible pour écouter et améliorer la vie du quartier. Il croyait réellement aux bienfaits de son métier et d’une certaine manière il y prenait du plaisir. Il louchait, il était beau. Ils s’aimaient avec une incroyable complicité pour rigoler.
Elle était arrivée de Marseille avec sa mère et sa sœur. Ils avaient vécu dans la rue avant d’échouer à la Muraille de Chine. Malgré leur petit salaire de concierge, ils embrassaient la vie, la croquaient à pleines dents, certains que leurs enfants allaient emprunter l’ascenseur social. C’était leur manière de se sentir tirés d’affaire et leur plaisir de surveiller leurs devoirs, d’imaginer ce qui leur ferait leur bonheur. Elle donnait vraiment la pêche. J’étais devenu son confident. Elle aurait pu devenir la mienne. Elle m’avait invité un soir à diner avec sa sœur : on s’était bien amusé. Avec ce genre de fille, j’avais toujours eu un feeling immédiat. Elle, elle était exceptionnelle : lucide pour analyser le naufrage de cet énorme barre d’immeuble qui avait été visitée par François Mitterrand et tous les ministres de la ville, optimiste et hédoniste pour apprécier les petits plaisirs du présent et envisager l’avenir comme un combat gagnant. J’avais un tel coup de cœur que je lui avais proposé mon appartement pendant une de mes absences en reportage ou en vacances afin qu’elle et sa petite famille découvrent Paris. Elle avait accepté sur le ton de la gaieté. De retour à Paris, je me laissais déborder : je partais pour le journal toujours au pied levé et j’étais à court d’argent pour des vacances. J’avais fait une promesse de Gascon. Je m’en étais toujours voulu. J’avais tellement désiré et je désirais encore leur faire plaisir, maintenir un contact. J’aurais aimé développer une amitié avec elle.
Depuis mes premiers jours, j’avais toujours eu un contact très fort avec des gens issus de la misère. Je n’avais même pas deux ans que j’étais dans les bras de Youyou, ma petite voisine de cité, une série de maisons ouvrières construites le long d’un stade de foot et d’une gare de triage. Sa mère était l’enfant naturel d’une prostituée et d’un client africain. Elle gueulait tout le temps. Youyou en avait gardé une épaisse tignasse bouclée et une peau dorée. Dès l’âge de quatre ans, nous étions « amants ». Tous les matins, je m’habillais à la hâte en ayant qu’une seule idée en tête : courir jusque dans la cuisine de Youyou où celle-ci était nue et debout dans une bassine remplie d’eau tiède et de mousse. Je bandais immédiatement. Nous nous cachions sous l’escalier, elle baissait sa culotte et me laissait caresser sa chatte de mes petits doigts. Je n’en pouvais plus de sentir mon sexe aussi dur. Nous disions que nous nous aimions, que nous sortions ensemble. Nous passions nos journées perchés dans des sapins, laissant la résine s’accrocher à nos peaux. Nous jouions au marchand et à la marchande avec des morceaux d’aliments que ma mère nous donnait, à la poupée, au docteur et à l’infirmière. Il y avait un pré à côté. Une fois le foin coupé, nous l’utilisions pour faire des cabanes odorantes. Nous nous occupions tout le temps. Chaque jeudi, elle avait le privilège d’obtenir 1 franc avec lequel nous achetions des bonbons. Elle l’utilisait souvent pour être capricieuse avec moi, décidant parfois de ne partager aucun de ses bonbons, ou de m’en offrir très tard dans la journée. Surtout, elle jouait souvent à me dire qu’elle n’était plus amoureuse de moi, que c’était fini. Je la croyais, j’avais du chagrin. Nous nous « raccordions » jusqu’à la prochaine crise.
J’étais troublé par la beauté de ses frères qui avaient dix-huit et vingt ans. Ils ressemblaient à des Tunisiens. Leurs cheveux étaient très noirs, leurs traits fins. Leur peau basanée me fascinait. Ils me faisaient un peur mais je trouvais qu’ils étaient les modèles du genre masculin. L’un d’eux était franchement voyou. Un soir, il cassa tout dans le café de la place et son beau-père, le pauvre Valentin dût indemniser le patron avec sa paye de manutentionnaire. Je venais d’un quartier périphérique dont il fallait taire le nom. Dans la ville, il évoquait « mal famé », lumpen prolétariat, fous dangereux, gitans. C’était vrai qu’il y avait un camp de gitans : ils nous laissaient tranquilles. S’étalaient aussi sur des kilomètres d’étranges cités d’urgence construite par les Alliés américains pendant la guerre 14-18. Installant en même temps la gare de triage, ils avaient fait pousser de petites maisons en carton et en aggloméré qui étaient toujours habitées dans les années soixante malgré l’absence de salle d’eau. Il n’était pas rare d’entendre des coups de fusils mais ça ne dissuadait pas ma mère de rendre ses visites ou de distribuer du lait gratuitement pendant mai 68.
J’aimais bien voir les Martinets s’envoler pour l’Afrique, arpenter une parcelle de sable jaune noirci par les fumées que j’imaginais en Sahara. L’été, j’y allais pieds nus, je me brûlais, je fermais les yeux, j’avais vraiment l’impression de marcher seul dans le désert. Surgirent des baraquements Algeco le long du stade de foot et des ouvriers-maçons algériens. Ils faisaient basculer notre cité dans une nouvelle ère : celle de deux immeubles qui allaient remplacer le pré et le désert, enserrer nos maisons et nos jardins. Les maçons travaillaient dur. Ils dormaient dans les cabanes, se faisaient à manger sur des petits réchauds. J’aimais aller les voir. Ils avaient des corps, la peau presque noire et burinée. Ils m’évoquaient l’ailleurs, l’Orient tout en l’ignorant. Ce lointain qui était en eux les rendait à mes yeux presque comme des dieux. Je les admirais, impressionné. Je les faisais rire. Ils finissaient par me dire : Faut pas rester là petit.
Je réalisais ces derniers temps que cette cité s’enorgueillissait d’être très solidaire, très syndicalisée. Je me souvenais avec grande amertume que personne n’était allé offrir à ces hommes seuls une marmite. Personne ne leur proposa de prendre une douche dans une salle d’eau. Avaient-ils des papiers ? Je ne le savais pas. Je me souviendrais toujours du sentiment de tristesse et d’injustice qu’ils m’inspiraient. Je rageais qu’aucune main ne s’était tendue du côté de ma cité. J’y pensais souvent quand les uns et autres évoquaient à présent les « les problèmes des banlieues » et la rage de certains enfants d’immigrés.

