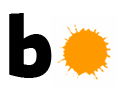



J’arrêtai donc ce fameux Zyprexa, un neuroleptique qu’on m’administra dès 1999. J’ignorais que l’imprégnation de sa molécule allait me mettre à terre. Je devais aller au travail. Je rampais sur mon parquet. Je vomissais. Mes diarrhées m’impressionnaient. Je ne pouvais plus manger. Je me vidais, exténué. Je croyais que c’était une sévère gastro, qu’il n’y avait rien d’autre à faire sauf à prendre de la vitamine C et dormir pour combattre le virus. J’étais soucieux de m’alimenter d’une manière ou d’une autre pour me rétablir. Je bus beaucoup de lait. Je finissais toujours par vomir. J’eus l’idée de ne boire que de l’eau avec du sirop à la menthe. J’en bus de grosses quantités et ça passait. Je finis par voir mon médecin qui me prescrit une série d’examens sanguins. Le matin où je devais la revoir avec mes résultats, une immense fatigue me saisit. Je m’endormis dans mon bain.
Une sonnerie de téléphone me réveilla. C’était le médecin qui me demanda de venir au plus vite. J’avais 5,5 grammes de sucre dans le sang, j’allais entrer dans un pré-coma diabétique. Elle devait me donner une lettre à remettre aux Urgences de l’hôpital Saint-Louis. Quand je la vis, elle était affolée. Elle me disait de faire vite, vite. J’hélai un taxi, expliquai ma situation. Le chauffeur me répondit qu’il n’était pas ambulancier. Il finit par céder quand je lui fis remarquer qu’on pouvait l’accuser de non assistance à personne en danger et surtout quand je lui hurlai que j’espérai qu’il ne vive jamais ce que j’étais en train de subir : un danger de mort.
Aux Urgences, je m’endormis. Je me réveillai dans un lit du bloc de réanimation. J’avais des perfusions, des écrans d’ordinateurs. J’entendais des bruits d’eau, des sortes de glouglou. On me dit qu’on me lavait le sang, tout allait bien, je l’avais échappé belle, j’allais m’en sortir, c’était une question de jours. Je m’endormais, me réveillais, conscient que je devais m’en remettre à la machine qui faisait son boulot. J’avais l’impression d’être dans le moteur d’une fusée à propulsion nucléaire. La haute technologie me fascinait, je la bénissais de me guérir. Je me sentais tout petit, en même dans l’excitation et le sentiment nouveau d’une renaissance.
A quelques mètres d’autres malades étaient entre la vie et la mort. Un vieil homme gémissait. Aux conversations de parents, je compris qu’il n’en avait plus pour longtemps. J’imaginais le corps de cet homme bruyant bientôt mort… Finalement on guérissait tous ici. Il s’en sortit comme les autres. Il n’y avait pas de lumière naturelle. Mon lit donnait sur une seule fenêtre séparant le bloc d’un couloir où était entreposée une immense poubelle en tissu. Le personnel soignant y jetait ses vêtements de travail usagés et c’était ma seule récréation de voir toutes ces femmes et ces hommes, ces corps et ces visages, ces expressions de fatigue ou d’absence, quelquefois des conversations où fusaient des rires.
J’étais vidé de toute notion de temporalité. Ma seule impatience était de sortir un jour _mais depuis combien de temps étais-je là ?_ pour fumer une cigarette malgré mes biceps bardé de patches. J’étais triste d’en être arrivé là, triste d’avoir chopé un diabète. Je pensais que la rencontre avec le Joueur était imminente. Je me retrouvais avec un autre avenir, celui d’un homme à l’identité sexuelle vague atteint d’une grave maladie. Quand je relevais la tête, une force magnétique s’empara de ma tête, la fit pivoter et l’immobilisa sur la couleur blanche d’un objet, ce qui signifiait que j’étais déjà, que j’allais être en paix. Cette force surnaturelle n’était autre que celle du langage du Joueur. Je retombai irrémédiablement amoureux de lui. Je me fichais de l’évolution de mon coma, je ne pensais qu’à lui, ne voyais que lui dans mon esprit. J’entrai en transe à force de lui répéter comme dans une lithanie (XXX) que je l’aimais, je voulais toujours plus, plus de lui, plus de présence dans mon imagination, dans mon cœur, dans mon corps. J’en pleurais. Des infirmières me demandaient des explications, je gardais le silence.
Arriva une aide-soignante. Elle était métisse, grande et athlétique, le portrait tout craché de Marie-José Pérec. Elle n’était pas aimable d’emblée. Elle s’approcha de moi, me tendit avec un large sourire, un journal gratuit ouvert à une page de publicité d’un équipementier sportif où figurait le Joueur en gros plan. Il était torse nu, regardait l’objectif, séducteur. Je débordais de mots de remerciements. Elle me souriait toujours, avec des yeux protecteurs où on pouvait lire un peu de tristesse et beaucoup d’affection. Connaissait-elle mon lien avec le Joueur ? Je n’osais lui demander.
Un soir, plusieurs internes et chefs de cliniques arrivèrent avec un cahier impressionnant par sa taille. Ils le posèrent sur un pupitre, l’éclairèrent avec une lampe qui diffusait une lumière de bougie. Ils me posèrent une cinquantaine de questions, sur ma sexualité, les drogues, l’HP, mon travail. Je n’en pouvais plus. J’étais étonné qu’ils insistent sur mes reportages de guerre. Il leur fallait des détails, je ne comprenais pas le lien avec le diabète, me forcèrent à redire la même chose, inscrivaient tout sur le cahier tout en se murmurant à voix basse des paroles que je trouvais bien mystérieuses. Je préférais garder l’impression de douceur que dégageaient la lumière et la sensation d’avoir affaire à une bougie.

