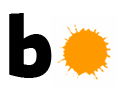



A la sortie de Roissy, le directeur-adjoint de la rédaction qui m’avait demandé de rentrer m’attendait, non sans que je fus bouleversé par des voix et des regards très insistants et hostiles de Blacks américains qui prenaient des postures de victoire en me regardant lourdement. La voiture et le chauffeur du PDG était de sortie. Le directeur-adjoint vint m’accueillir en m’embrassant (il embrassait tout le monde) accompagné d’un chef de service autrefois médecin.
– Tu nous as fait peur. C’est fini. Tu vas pouvoir te reposer, te soigner.
– On m’a empoisonné, j’ai été menacé ! Je le suis toujours. Rien qu’il y a cinq minutes dans la salle des bagages, des Américains m’ont encore nargué.
– Quoi ?
– Ils ne me croyaient pas.
– Tu as mal entendu.
Selon eux, le poison, le journal, les agents secrets à Podgorica, à Dubrovnik, tout était sorti de ma tête qu’il fallait désormais soigner. Ils n’étaient pas sur place mais horriblement sûrs d’eux pour dire que rien d’anormal ne m’était arrivé. Ils avaient eu Georges au téléphone. La belle affaire !
– Il connaît Podgorica comme sa poche. S’il avait eu des inquiétudes, il nous en aurait fait part. Non, il était inquiet pour toi.
Je me raccrochai au journal trafiqué néo-nazi. Ça c’était une preuve tangible.
– C’est hallucinant cette histoire, j’ai relu la copie. T’imagines bien qu’on n’aurait pas publié un truc pareil. Tu vois bien, il faut te soigner.
Je me baladais entre les étages du journal pour aller me chercher un café. Dans l’ascenseur, j’aperçus un type qui me semblait appartenir à une unité d’élite, genre BRB (brigade de répression du banditisme), habitué aux interpellations musclées. Il était à un étage, surpris que je le vis. J’entendis des filles rigoler. Le visage du type s’assombrit quand il me reconnaissait, mal à l’aise d’être à découvert. Je m’enfuyais aussitôt. Un flic au sein du journal !
Je descendis voir le directeur-adjoint de la rédaction :
– C’est bourré de flics ici !
– Tu divagues.
Le journaliste-médecin m’invita à nous isoler dans l’un des bureaux particuliers de la chefferie.
Il me fit subir un long interrogatoire sur mes aspirations et mes souffrances personnelles, sur mon idée du bonheur, sur mes frustrations professionnelles et amoureuses. C’était étrange. J’avais l’impression d’avoir affaire à un psychothérapeute (il employait le même ton) et pourtant c’était un membre éminent de la hiérarchie. Je vécus ce moment comme un mélange des genres, une violation de l’intime, un passage en force, une méthode de psychiatrie soviétique en entreprise. Et moi, je me faisais mon bon soldat, je répondais aux questions et ne lâchais pas l’affaire pour prouver que j’étais au centre d’une machination, que je n’avais rien à cacher. Nous parlâmes de l’homosexualité. Et bizarrement, nous terminions sur ce que je désirais ardemment au fond de moi. Pour être honnête, j’aurais dû lui soumettre mon utopie de vouloir me transformer en femme avec l’homme que j’aimais pour avoir des enfants de lui. Mais tout s’embrouilla et je sentais que je n’étais pas en terrain sûr avec mon interlocuteur. Je lui mentis :
– Finalement, je serais serein si je rencontrais une femme et si j’avais des enfants avec elle.
L’entretien était déplacé. J’avais été empoisonné et personne ne voulait m’entendre, me croire, le consigner pour déclencher une procédure d’accident du travail. Personne ne faisait un effort sérieux pour scruter la personnalité de Georges. Au contraire, il apparaissait toujours comme un type serviable, insoupçonnable.
J’avais été exposé à des menaces, à un danger, à l’administration d’une drogue puissante et personne ne voulait l’entendre. J’étais confronté à un mur où l’on niait ce que j’avais vécu. On préférait ne pas reconnaître que j’avais été victime d’une agression mais me démontrer que tout partait de moi, que c’était moi qui défaillais, moi, désormais atteint d’une maladie mentale qu’il fallait soigner.
Le poison, je ne l’avais pas inventé, les coups de bâton la nuit, l’attitude très hostile de Georges, je ne les avais pas inventés. On soupirait en m’entendant. Je réalisai qu’ils avançaient une incrédulité, une incroyable légèreté quand on avait dans ce cas affaire à un reporter qui revenait d’un pays d’après guerre. Ils préféraient me dire que mon cas relevait désormais de la psychiatrie, me donnèrent deux adresses de spécialistes qu’ils avaient choisis, me conduisirent à l’un d’eux. J’étais affaibli et d’une certaine manière, je voulais les croire, oublier ce cauchemar, sans doute réinventer le passé, celui de la dénégation en me disant : plus jamais je ne retournerai au Monténégro, ça n’allait peut-être pas recommencer à Paris, il faudrait que je prenne sur moi. Je cédai. J’étais clivé : une partie de moi savait pertinemment ce qui m’était arrivé, une autre s’en remettait à la voix collective du journal qui cherchait à nier farouchement cette histoire de poison, d’espions à Dubrovnik, d’un dispositif qui avait cherché à me nuire. J’étais exposé à un danger, on ne le reconnaissait pas, c’était à moi de me soigner. On aurait pu faire faire des analyses de sang, chercher les traces et l’identité de la substance qu’on m’avait administrée. J’en ressentais d’ailleurs toujours les effets. Ils n’étaient sans doute pas pour rien dans le fait qu’une partie de moi-même s’en remettait à eux pour être docile, écouter leurs conseils, diagnostiques. J’avais été agressé ? Non, j’étais devenu parano ! Une autre partie de moi-même était révoltée. Tous ceux qui m’avaient recommandé Georges comme une personne irréprochable et réellement efficace me faisaient peur.
Je m’en voulais qu’une partie de moi-même lâcha et se laissa convaincre que rien de bien grave ne s’était passé, que sans doute, je sombrais dans une paranoïa due à l’épuisement. Il y avait dans ce journal la posture solide d’être toujours un bon petit soldat, d’être révérend face au jugement collectif, une peur d’ être exclu de l’équipe, et, point sacrément crucial, obsessionnel, niant tout libre arbitre : la nécessité de ne jamais perdre la confiance du journal, de ne jamais rompre un lien, de ne pas se révolter même si l’évidence de mon empoisonnement et de sa négation m’aurait dû pousser à le faire. J’étais affaibli. Je me laissai conduire chez le psychiatre choisi par la maison. Celui-ci écouta le procès et les crimes que je m’inventai. Il me prescrit des médicaments ultra-puissants à prendre impérativement sinon c’était l’internement. Une nuit passa. Je voulus revenir à la charge au journal avec cet exemplaire néo-nazi que j’avais conservé. Il avait disparu.
Je restai prostré une journée dans mon appartement à imaginer que si personne ne me croyait, les crimes de pensée que je m’étais inventés étaient des motifs suffisants pour qu’on m’arrêta. Le poison continuait de faire ses effets. J’allais sans doute être exclu du monde, le salaud que le poison voulait dessiner de moi allait faire de moi une loque soumise à la vindicte populaire. Le directeur-adjoint de la rédaction vint me voir, écouta mes prédictions. La boucle était bouclée : le poison m’avait transformé en paranoïaque et le journal pouvait avoir raison, non pas pour nier que j’avais été empoisonné, mais pour constater que je souffrais désormais d’une réelle pathologie mentale.
– Il faut que tu te soignes, répéta-t-il.
Je ne pouvais plus rien lui démontrer de ce qui s’était passé à Podgorica. Il se leva pour ouvrir la fenêtre et faire un signe rassurant vers le bas, vers la rue. Je lui demandai :
– Mais qu’est-ce que tu fais ? Tu t’adresses à qui ? Aux flics ? A quelqu’un du journal ?
Il était très gêné, prit un air faussement dégagé d’un compagnon de comptoir :
– Mais rien, je te dis.
Puis il décida de me faire venir dormir chez lui. Les médicaments m’assommèrent. Il me convainquit que j’étais quelqu’un de très bien, que Georges aussi était quelqu’un de bien. Je m’endormis en me disant que je n’y arriverai pas.
Rencontrés une première fois gare des Invalides en 1991, les services secrets ne me lâchaient pas. Et ça, c’étaient des faits. Rien que les faits…

