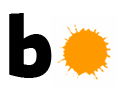



Zyprexa, c’était le médicament miracle. Il était enfermé dans du beau papier argenté. Il évitait de se faire interner. Il faisait prendre trente, puis quarante kilos en quelques semaines, provoquait le diabète en effet secondaire. Je pris tout d’un coup : les kilos et le diabète (soins intensifs et tout le reste).
Il fallait absolument soigner cette paranoïa, me disait le discours amical et médical du journal. Il ne fallait pas soigner le fait que j’avais été soumis à un danger, subi une agression (le poison), voire un viol de la personnalité via ses effets. Il ne fallait pas investiguer de ce côté-là, soumettre le Georges à la question, alerter les services secrets pour expliquer les faits, procéder le plus rapidement possible à des analyses de mon sang qui avait absorbé une « bombe atomique » chimique. Rien de ce côté-là. En revanche un solide dispositif d’échanges de couloir, de recommandations au café s’était mis en place pour me convaincre que c’était moi qui était devenu malade, que cette paranoïa m’était tombé dessus parce que j’avais trop donné dans les reportages de guerre, d’autres reportages difficiles, qu’il fallait prendre du recul, envisager une nouvelle vie. Pour moi, c’était broyer à jamais cet épisode du poison, du bâton qui tapait à ma fenêtre toute la nuit, du mystère de ce journal trafiqué. Il fallait non pas résoudre les problèmes que cela posait, ni même se guérir correctement des effets de cette agression mais créer carrément une autre identité, celle d’un journaliste-reporter qui à trente-huit ans développait une maladie survenue de nulle part, ou disons d’une peur, d’hallucinations, de stress. J’étais psychiquement réinventé, une réalité (celle des faits de Podgorica) disparaissait, elle devint à l’instar de ce fameux Georges tabou.
J’étais au bout d’un moment découragé d’asséner tout le temps que j’avais été empoisonné, finis par me laisser faire, pris le médicament et voulus me mettre à l’abri avec lui. Il me faisait oublier, dormir quatorze heures par jour, manger davantage, retenir l’eau de mon organisme. Je savais qu’il me fallait un médicament pour me soigner des effets d’un traumatisme subi, pas un de ceux qui signait le fait que je l’aurais inventé et ensuite sur interprété. Quand je repense à cette eau de la bouteille de la cuisine de Podgorica, je me souviens encore de l’explosion dans ma tête, de la panique qu’elle a engendrée, des troubles d’accusations odieuses que je proférais contre moi-même. Ce poison m’avait bien déréglé. Il m’eût fallu l’antidote. A défaut, je prenais ce zyprexa pour m’engourdir. J’avais tellement besoin de dormir. Je cherchai avec énergie à sortir des griffes du psychiatre pas sympathique sur lequel le journal m’avait dirigé, pour passer par une consultation à la clinique Laborde et échouer dans le cabinet de son correspondant parisien, très à l’écoute et soit dit en passant, attachant une grande importance à mon aventure de ballon, me conseillant de ne me fâcher ni avec cet univers, ni avec le Joueur, ni avec le langage cosmique qui nous unit et d’écrire sur ce savoir que je suis constitué afin de le diffuser.
J’appris à changer de vêtements, à réaliser que je n’habitais plus mon corps, souvent mal latéralisé quand je croisais des gens dans le bus ou le métro, les bousculant, pas encore conscient que mon enveloppe, ma carrure s’étaient élargies, pas encore vraiment informé que j’étais devenu un gros, qu’il fallait appréhender d’une nouvelle manière l’espace, la foule, les poteaux, les obstacles et le regard des autres.
Seul un ami s’excitait avec moi sur une plage de Biarritz. Photographe, il devenait fasciné par mes courbes : du crâne, des bras, du ventre, de l’ensemble rond. Il mitraillait et réussit à tirer quelques clichés de drôles d’hémisphères…
Au travail, je me mis en tête de raconter l’Opéra de Paris de l’intérieur. Ça me reposait de lézarder à la cafétéria de l’école de danse à Garnier, de m’émerveiller sur ces corps sculptés, de traîner à la salle des perruques, d’assister avec assiduité aux répétitions des Noces du Figaro même j’étais sur le cul d’entendre au café le chef d’orchestre suisse bourré marmonner des blagues antisémites. Il y avait des syndicalistes revendicatifs, d’autres désespérés racontant l’alcoolisme, l’ennui, la routine. Il y avait le miracle du chant, de Mozart, des machineries, des saillies d’humour et de fantaisie. Je marchai au ralenti, y allai tous les jours comme j’allai à un centre de rééducation. Je découvrais ce que voulait dire prendre son temps. Cela me guérit un peu.
Au journal cela devenait récurrent de me signifier qu’une page était tournée, que j’entrais dans le clan des vieux. Je ne voulais pas me sentir fini : j’avais trente-huit ans…

