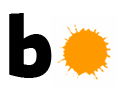



La nuit avant la finale, je n’avais dormi que trois heures. J’avais vécu un monologue ininterrompu avec le Joueur pour le soutenir, déclarer cet étrange amour, tenté de lui transmettre toutes mes forces mentales et physiques même si je me sentais au bout du rouleau. Ces matches avaient été une série d’épreuves où je vivais l’enfer, le suspense, l’impuissance, les nerfs à vif. Je ne pouvais m’empêcher de culpabiliser en cas d’échec. La France était sur le point de décrocher la Coupe. Je voulais absolument fuir le confinement, l’ambiance petits bobos à moitié concernés par la compétition dans le restaurant où j’avais suivi les matches précédents.
Je réussis à convaincre mon ancienne traductrice à Brasilia qu’elle trouve un lieu sympa en plein air, qu’elle m’accompagne : j’avais peur d’être seul au milieu de la foule avec cette conscience d’être le ballon et la torture de mes pensées parasites. Il fallait que je me raccroche à quelqu’un. Elle comprit et me proposa d’aller à Montreuil où vivaient sa meilleure amie et son mec, un Kabyle serveur dans un café.
Le soir, nous sommes d’abord allés voir celui-ci. Il n’était pas très chaleureux. Nous partîmes aussitôt à la recherche d’un endroit. Nous nous promenions dans une rue piétonnière et nous arrêtâmes devant une vaste terrasse qu’un marchand de kebabs avait aménagée pour l’occasion devant une télévision. Nous trouvions place parmi une soixantaine de personnes. Un petit gros Arabe de 16 ans s’occupait d’un barbecue posé dans la rue. Je le regardai, lui trouvai un certain charme et me répétai inutilement que je n’avais pas envie de baiser avec lui. C’était idiot et entêtant : je n’avais aucun désir pour lui, c’était clair mais il fallait que je me le répète. Je me disais que c’était un nouveau type de pensée parasite. Vraiment, il était trop jeune, trop gros, j’aimais trop les hommes, jamais les ados. C’était trop bête.
L’ambiance était bon enfant. Il y avait beaucoup de familles arabes, je me sentais bien. Flottait une odeur de grillades. Il ne fallait pas être pressé pour avoir sa commande. Jamais je ne sentais autant de liberté à sentir ma tête presque dans le ciel tellement j’avais souffert de l’enfermement, de la promiscuité et d’un plafond bas dans le restaurant où j’avais vu les précédents matches.
J’étais tellement heureux et soulagé. La partie avait beau être commencée que je penchai ma tête vers les étoiles pour les admirer et déguster la brise qui nous faisait sentir le plaisir du plein air. Cela m’invitait à une certaine décontraction, voire à un relâchement, une certaine détente malgré la tension sur le terrain. Je vivais les premières minutes avec une distanciation et un repos de l’âme qui me surprenait et me donnait envie de déconner. Ce nouveau confort me distrayait du ballon. Je regardais les gens, je retrouvais ma posture de spectateur d’autrefois : dilettante malgré l’enjeu.
Je m’inquiétais quand même pour le Joueur. Il était sérieusement attaqué par des Italiens qui usaient tous les moyens pour le mettre à terre. J’entrai dans une rage folle. Un carton rouge pour ces derniers n’aurait été que justice. Je fus livide de le voir sérieusement blessé à l’épaule au point de le voir sur un brancard, rassuré quand il se remit à courir. Son pénalty, je n’ai rien compris. Les commentateurs s’extasiaient, disaient que c’était un but de folie, rare dans l’histoire du football. J’étais heureux et fier et un peu vexé de n’avoir vu qu’une balle entrer dans la cage en tapant la barre du haut. Je comprenais quand même que ça ressemblait à l’exécution d’un goal dont j’ignorais qu’il était le meilleur du monde.
C’était bien parti, j’étais sûr que les Bleus, le Joueur allaient gagner. Il ressembla à un tigre quand il loupa de peu un magnifique but. Je le sentais blessé et en capacité d’accomplir des actions extraordinaires, de s’envoler, créer encore plus, développer son art et combattre comme un roi-soldat avec majesté et une pugnacité qui jaillissait de ses yeux et de sa bouche. Il était l’homme au-delà de ses limites, voltigeur et enraciné, un regard à 360°, une perception des placements et des déplacements de ses partenaires qui relevait d’une anticipation de sorcier. Malgré les coups, la douleur, les tricheries, il se battait comme un lion ensanglanté, un esthète entêté sachant détourner obstacles et contrariétés. C’était la rage et la beauté.
J’étais trop confiant, trop à l’aise sous mon ciel étoilé. J’entendis le commentateur s’exclamer :
Oh non pas ça ! Pas ça !
La caméra zoomait sur un footballeur italien à terre, puis le visage plein de fureur du Joueur. Des images au ralenti montrèrent l’arrière italien parler au Joueur qui se retourna vers lui, surpris et provoqué. En une seconde son coup de boule lui fut expédié sur le plexus solaire. Je ne comprenais pas, prêt à condamner le geste. J’étais certain que l’Italien avait proféré des paroles d’une très grande gravité, voire des menaces de voyou pour que le Joueur réagisse ainsi. Il n’était pas fou. Il y avait un coup de fatalité. Choqué, vexé pour l’issue du match, j’étais persuadé que le Joueur avait ses raisons. Je lui faisais confiance. Nul doute qu’il avait réagi à un scandale, à des menaces, à une forfaiture. La manière dont parlait l’Italien sentait l’agression, et pourquoi pas les pires paroles qu’un homme pouvait proférer. Il l’avait fait avec l’assurance d’un voyou, d’un maffieux, d’un malfrat.
Le carton rouge fut levé. Le Joueur quitta le terrain sans un geste du sélectionneur. A jamais gravée dans ma mémoire fut l’image du Joueur descendant quelques marches vers les vestiaires, la tête baissée, son immense cou que j’eus voulu couvrir de baisers.
J’étais effondré. Nous allâmes dans un café. Je ne voulus pas rester. Arrivé chez moi, je ne savais plus où j’habitai. Je ne pouvais admettre que ce coup de boule, c’était du réel. La perspective de se voir le lendemain était anéantie. Je lui parlai, le consolais tout en étant complètement paumé.

