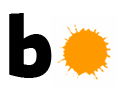



Vu qu’on se rendait au Congrès de Reims, je suis passé en vitesse, la veille, à la librairie du Labyrinthe. Histoire qu’on embarque un peu de littérature à remuer les socialistes : Le grand Bond en arrière de Halimi, La Lettre ouverte de Hocquenghem à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary, La Société des socialistes de Lefebvre et Sawicki, ma Guerre des classes bien sûr.
« T’as que ça ? » je houspillais Philippe, et je fouillais dans sa réserve. « Mais c’est quoi ce bouquin ?
![]() Oh je sais pas trop. C’a l’air d’être marrant. C’est plein de cul, je crois. J’allais renvoyer les deux exemplaires, je ne les vends pas.
Oh je sais pas trop. C’a l’air d’être marrant. C’est plein de cul, je crois. J’allais renvoyer les deux exemplaires, je ne les vends pas.
![]() Je te le prends, on verra bien… »
Je te le prends, on verra bien… »
Bon : à Reims, on n’a pas déballé la camelot. Il crachinait. On ne voulait pas mouiller les couvertures. Mais j’ai lu ce bouquin, Je n’ai jamais rencontré Mitterrand, ni sa femme, ni sa fille, et j’ai passé un super week-end. A me bidonner. Oui : à me marrer sur les lendemains qui déchantent…
C’est un roman d’apprentissage – sentimental, culturel, mais aussi politique. Où, donc, la naïveté s’en va. Car le 22 mai 1981, Etienne, jeune prolo, tantôt ferrailleur, tantôt plombier, tantôt coursier, y croit : « La société allait se retourner comme un gant : ceux qui en avaient bavé seraient les rois du monde, et inversement. Nous la tenions notre revanche. On allait voir ce qu’on allait voir, les patrons pouvaient trembler et les capitalistes planquer leur pognon en Suisse. Moi, je m’imaginais rentrer à l’Elysée, trinquer avec le président de la République puis traverser Paris sur mon scooter, le poing levé sous les hourras des ouvriers vengés. Bon, rien ne s’est passé comme prévu… »
Dès le début, dès le « 10 mai 1981 », rien ne se passe comme prévu : ce soir-là, Etienne arrive trop tard « en scooter à la Bastille, la fête était finie. Les voitures roulaient à nouveau autour du Génie. » C’est que, ce dimanche, il ne pouvait « pas laisser filer le petit déménagement en banlieue et les 400 francs à la clé », et qu’il a bien fallu, ensuite, « ramener la camionnette de Nordine à 2 h 30 du matin à Aubervilliers. »
Une année durant, alors, lui va poursuivre François Mitterrand, et pour apercevoir son idole va jouer les vigiles à l’aéroport, enfiler une tenue de cosmonaute à Versailles, s’endormir au sous-sol du Congrès de Valence sur un paquet de linge sale.
« Tu veux toujours buter tous les patrons ?
![]() Mauroy va s’en occuper pour moi. Les socialistes ont commencé le boulot. Aujourd’hui, ils ont augmenté les minima sociaux et le taux directeur de la banque de France.
Mauroy va s’en occuper pour moi. Les socialistes ont commencé le boulot. Aujourd’hui, ils ont augmenté les minima sociaux et le taux directeur de la banque de France.
![]() Et ça fait quoi ?
Et ça fait quoi ?
![]() Je sais pas. »
Je sais pas. »
Malgré le gouvernement Mauroy, rien ne change : tandis que le « 29 juin 1982, Nicole Questiaux laisse sa place à Bérégovoy au ministère des Affaires sociales », Etienne évacue une cave envahie par les excréments : « On a tapé comme des fous, de toutes nos forces, de toute notre jeunesse et de toute la hargne d’être obligés de baigner dans la merde pour survivre. »
A chaque date de l’épopée socialiste répond ainsi une journée ordinaire d’Etienne. Et ce roman pourrait s’intituler, « La Gauche vue d’en bas ». Ou encore : « Une histoire populaire de 1981 » : « Moi, je ne sais pas pourquoi, j’ai toujours voté pour les communistes. Ce n’est pas que j’aie particulièrement bénéficié de leur gestion municipale. Non, plutôt parce que je pense que c’est ce qui emmerde le plus la droite. »
Les espoirs politiques s’effilochent : avec Maman, « on a parlé de rien, mais surtout de la gauche qui ressemblait tellement à la droite (avec de la barbe) que vu d’Aulnay, on ne voyait plus la différence. J’ai essayé d’avancer quelques arguments, mais ils sont tombés à plat face au plan de restructuration de l’usine de tréfilerie de Poissy où bossait mon père. »
Mais ça ne fait pas sombrer Etienne dans la dépression. Lui compense par une heureuse débauche, avec Carina, Marithé, Hélène, Luce, etc. Converti, d’ailleurs, à la « collaboration de classe » bien avant Mitterrand : dès le 26 mai 1981 (jour où « Gaston Deferre, ministre de l’Intérieur, suspend les expulsions d’étrangers en situation illégale »), la bourgeoise Christiane, « charmante épouse du patron de Moribato », lui enseigne l’art du cunni et l’invite à « Saint-Raph’ ».
Et ce sont les femmes, encore, qui l’initieront au cinéma, à la littérature, au théâtre, élargiront sa banlieue jusque Avignon. Témoin d’une gauche qui, faute de conquêtes sociales, jouira de la liberté des mœurs et de la Culture. Témoin d’autre chose, aussi : qu’à observer l’histoire de haut, on l’écrase. Tandis que la joie survit même dans les heures de reculade sociale.
Voilà. Je voulais vous parler de ce roman. D’abord, parce que c’est rare, les textes pertinents et drôles. Ensuite, parce que c’est triste, les livres qui passent inaperçus, qui ne trouvent pas leur public, à cause de critiques paresseux, incestueux, qui ne chroniquent que les derniers pensums des germanopratins rassasiés de gloires.
Enfin, parce qu’on m’a demandé, « mais pourquoi tu intitules ton blog ‘populiste’ ? ». Et que, pour répondre, je voulais renvoyer à la définition du Petit Robert : « Populisme. n. m. – école littéraire qui cherche, dans les romans, à dépeindre avec réalisme la vie des gens du peuple. » Et que je voulais signaler, aussi, que Yves Gibeau, un de mes écrivains favoris (l’auteur d’ Allons z’enfants et de Mourir idiot) avait reçu « le prix du roman populiste ». Et Louis Guilloux (Le Sang noir) à son tour, et Eugène Dabit (Hôtel du Nord). Et René Fallet (le copain de Brassens). Et Maurice Carême, dont on récite parfois les poésies à l’école primaire, dont les instituteurs livraient les textes en dictées.
En petit cousin de ceux-là, Etienne Liebig aurait bien mérité ce prix-là, et cet attribut de « populiste », d’avant que les journalistes, les politologues, les éditorialistes ne mettent leurs sales pattes sur ce joli mot, et ne le transforment en insulte.

