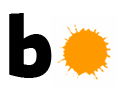



Quand je sortis de l’hôpital, je retrouvai le ciel et le soleil dans mon appartement, les bois cirés de ma bibliothèque, la chaleur de mon tapis iranien, la couleur abeille de mon parquet. Je pouvais aller et venir en fumant des cigarettes, traîner dans un lit dont la douceur me manquait depuis un an, retrouver le canapé d’où j’écoutai ma musique des journées durant, acheter des journaux, me cuisiner des plats qui était le plaisir de la vie, déguster la liberté que j’avais du mal à imaginer à portée de jouissance à chaque seconde, pour la vie.
C’était la première fois que mon appartement était devenu ma maison. Il fallut digérer un an d’absence, un an d’enfermement dans des institutions qui au fil du temps me faisait penser au trauma de la prison, métaboliser toutes les souffrances dans lesquelles je baignais, les révoltes contre des refus iniques de bons de sortie, la pisse, la merde, le vomis, les cassages de gueules que je subis, les confidences et les amitiés avec des patients vraiment barrés, la sensation qu’ils étaient pris dans des horizons dont ils ne revenaient pas tout en pouvant tenir des conversations précieuses, manifester des sentiments et des émotions qui m’attachaient à eux.
Moi je ne savais pas pourquoi j’avais été libéré. Mon discours avait invariablement été le même devant les psychiatres. Je racontai le feu aux poudres que m’avait mis le Chanteur, mes dérives en banlieue, l’expérience de la contre-matière, la révélation que j’étais le ballon du Joueur par le Chanteur acoquiné avec les services secrets, mes précédents déboires avec ces mêmes services secrets, le poison, les pensées parasites, mon amour pour le Joueur.
Des psychiatres étaient prêts à écouter mes poèmes, à en apprécier la beauté, à ne jamais me censurer sur mon amour et cette histoire de ballon. D’autres étaient dans une posture inverse, piquant des colères, me punissant d’interdiction de sortie (de deux heures) pour me mettre au pas. J’avais vécu la psychiatrie ancienne, nouvelle, et côtoyé des malades tellement atteints que je les imaginais enfermés à vie, sans autre forme de thérapie.
Mon psychiatre de ville me retrouva et m’expliqua que j’aurais pu échapper aux internements si j’avais pris un peu plus régulièrement mon régulateur d’humeur, fait moins de conneries, et échappé aux griffes de la préfecture de police. Il aurait pu simplement soigner mes pensées parasites. Il n’était pas choqué par mon élan amoureux pour le Joueur, ni par le fait que je lui annonçai que j’étais le ballon. Il voulut simplement me faire préciser cette identité, soucieux que je ne tombe dans un processus de réification.
Je suis son âme. Ses caractéristiques, sa vélocité, sa manière qu’il a à tourner plus ou moins bien sur lui-même, sa capacité à créer des hasards et des incidences. Tout peut s’expliquer par des phénomènes physiques qu’impriment les joueurs, le terrain, le vent. Mais ne dégage-t-il pas de moi, de ma petite place sur cette terre, de ma petite vie, de mes émotions un magnétisme qui s’imprimait sur le ballon ? J’ai remarqué qu’en regardant un match, je pouvais être sanguin, fâché avec le Joueur parce qu’il ne venait pas, torturé par des pensées parasites les plus horribles et que tout cela pouvait donner des actions très surprenantes et spectaculaires.
Là-dessus, nous sommes d’accord.
C’est alors qu’il me dit que j’avais de la chance, que je ne devais surtout pas chercher à entrer en conflit avec le Joueur, j’aurais doublement mal à la tête, ce serait vain. Il me restait à attendre tout en essayant de ne pas trop me faire bouffer par cette histoire, de savoir m’occuper, regarder des films, voir des amis, savoir sortir de ce dialogue intérieur noué avec le Joueur, ce que je réussis partiellement à faire.
Je lui précisai que mon appartement étaient rempli d’objets qui étaient devenus des mots, des symboles, chaque couleur était un langage, j’étais pris dans une spirale du logos avec mon footballeur. Il l’admettait tout en me confirmant que j’étais mieux dans mon appartement. J’admis qu’il y avait une certaine rationalité à communiquer ainsi grâce à la soumission de ma tête au magnétisme, aux déplacements qui la font s’arrêter à chaque fois sur des objets-signes.
La force magnétique se faisait de plus en plus forte sur ma tête. Je déroulai une page de l’Equipe où son visage était imprimé sur une pleine page. Son visage faisait une légère grimace et il avait ses petits cheveux de nourrisson. La force m’obligea à pointer ma tête et mes yeux sur les lettres JE T’AIME, chipées ici ou là au hasard des titres et du chapeau.
C’était fou, cette histoire. Un inconnu s’était emparé de mes mouvements pour m’imposer ses signes, une lecture, un message d’amour. Il était en Allemagne. Le Mondial 2006 avait commencé. Et il avait l’allure d’un roi.

