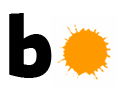



J’avais enfoncé ma carte bleue dans l’appareil automatique qui me délivra une carte magnétique pour entrer dans ma chambre ainsi qu’un récipicé de paiement. Je gravis le premier étage de ce qui ressemblait à un petit ranch avec une terrasse donnant sur les voitures du parking. Je me trompais de chambre et entrai dans une occupé par un Maghrébin et sa femme. Il faisait chaud, ça faisait du bien. L’homme se leva précipitamment et prit une posture de défense. Il était beau. Je lui demandai pardon et trouvai enfin ma chambre.
La carte magnétique ne marchait pas. Je croyais qu’en reculant, en tournant le dos, en fixant des angles latéraux, je pouvais la faire ouvrir de mon regard laser de chat. Rien n’y fit. Je multipliais les opérations magiques. Sans réussite.
Je redescendis, achetai une nouvelle carte magnétique qui elle non plus ne fonctionna pas. Je recommençai une troisième fois l’opération, en vain.
Je pris la décision de dormir sur la terrasse. J’avais trop froid. Je rêvais d’une chambre chauffée où je pouvais mater une chaîne de cinéma comme l’indiquait la publicité. Au lieu de cela, je patientai debout à regarder les étoiles du ciel en fumant. Je fus surpris en réalisant que l’une d’elle se déplaça, puis une autre, puis une autre encore. Au total une dizaine de petites lumières du cosmos avaient bougé et s’étaient regroupés dans l’axe de mon regard. Je fus effrayé. J’étais persuadé qu’il s’agissait de satellites militaires de superpuissances et qu’elles allaient m’envoyer des missiles ou des rayons qui allaient me détruire sur place.
Motif : j’incarnais trop le diable, le concentré des forces maléfiques de cette humanité, j’allais ainsi la soulager du mal qu’elle portait en elle car ce mal s’était désormais déplacé d’elle en moi, c’était la fin, c’était sa purification en me rayant violemment de la carte.
Je protestais. Je parlais à voix basse, en tremblant mais en entrant dans une concentration et une solennité extrême pour rappeler que je me suis toujours battu pour l’émancipation des hommes et des femmes d’où qu’ils vivent, quelles que soient leurs conditions, avec une révolte particulière pour les plus démunis. Les souvenirs remontaient et j’ai raconté ma vie de reporter, comment j’étais allé au charbon, comment chaque immersion m’avait permis d’ajouter un segment à ma réflexion et que de manière pragmatique, je m’étais construis une vision du monde dans laquelle j’étais à la fois accablé par l’accélération de l’aliénation et affermi par un espoir que j’avais nourri dans les situations de guerre les plus désespérantes et dans les banlieues, les grèves, un centre de soin palliatif…, chez des hommes et des femmes qui choisissaient de ne pas renoncer. J’étais bluffé par les aptitudes chez les plus modestes à se relier dans le fleuve millénaire des luttes d’émancipation en s’y abreuvant et en le faisant grossir encore de leurs paroles et de leurs petits gestes d’attention et d’entraide, bref j’avais la vision d’une humanité en souffrance mais en marche dans une période de révolution technologique et de dictature des ventres et des esprits qui pouvait déboucher sur le pire mais réserver aussi quelques surprises par une réaction propre un jour à faire vraiment flipper les maîtres et baisser leur garde, rendre l’âme ou prendre la poudre d’escampette, victimes de la tourmente qu’ils auront provoquée dans leur aveuglement d’un pouvoir total sur les âmes et les corps. Je croyais au retournement de l’Histoire et je n’étais pas prêt à abandonner quand il s’agissait, moi le faible, d’écouter les plus faibles et de relayer leur vérité étant intimement persuadé que celle-ci était l’arme la plus tranchante et meurtrière face aux dragons de l’argent et des marchands de mort.
Une question vint s’insinuer dans mon esprit. Elle surgissait d’un des maîtres manipulateurs des satellites que j’avais en face de moi :
Nous avons remarqué que vous protestez pendant vos pensées parasites. Mais nous sommes persuadés qu’à certains moments, ce sont des protestations d’usage et qu’en réalité vous n’éprouvez aucune émotion, vous baissez la garde. C’est bien cela le problème…
Je restai sans voix. D’autres étoiles-satellites s’agglutinèrent aux autres. J’étais dans le doute perpétuel. Et si la voix disait vrai. J’essayai de répondre à cette hypothèse même si au fond je la contestais mais quand bien même. J’avais les coudes posés sur la rambarde de bois, le corps cassé en deux, le cul en l’air et j’imaginais que dans une autre réalité j’étais actuellement âgé de vingt ans de moins, que j’avais été enlevé et que je me faisais enculer par un criminel nazi autrichien dans le Tyrol. Effectivement, je ne ressentais plus rien. Après autant de viols que je subissais en même temps que je parlais dans cet hôtel du Pontet à quelques kilomètres d’Avignon, j’étais devenu un objet mort, une poupée de chiffon que possédait ce vieillard hideux et libidineux. Mon dégoût m’avait anéanti, ôté tout espèce de sensation, de révolte, je n’existais plus, j’étais comme en état de mort clinique, peut-être sous l’effet d’une drogue ou d’une destruction telle que je ne la ressentais plus. Et je répondais à mon locuteur : vous voyez c’est bien ça le problème tant que je suis ici et en même temps au Tyrol sans défense face à cette charogne omnipotente, il se peut que je souffre de désordres émotionnels.
J’étais persuadé que j’avais trouvé la clé à une accusation dont moi-même, je ne pouvais évaluer la validité car j’imaginais qu’ils disposaient d’appareils de contrôle sophistiqués mesurant mes degrés d’émotivité et que je ne pouvais rien face à des données objectives.
C’était facile de me convaincre mais facile pour moi de trouver qu’il y avait en moi une thrombose, quelque chose de mort qui ne pouvait ressusciter et qu’il fallait faire avec. Je m’étais peut-être trop longtemps battu pour que je ne fus qu’un homme comme s’il fallait se battre pour le devenir. J’étais fatigué. Il était cinq heures du matin. J’avais faim et toujours froid, debout malgré les muscles qui lâchaient.
Me vint la conscience quand dans ma précédente vie, j’étais une femme allemande juive, enlevée puis transportée à Madagascar dans un laboratoire secret tenu par des médecins chercheurs fous nazis. Ils expérimentaient de nouveaux produits hautement toxiques sur mon corps. Je souffrais d’atroces douleurs. J’étais jetée dans les bras d’Africains que l’on forçait à me violer puis l’objet à nouveau de nouvelles expérimentations médicamenteuses qui ressemblaient à des poisons. J’ai aussi été abusée par des singes, des chiens et on me plaçait en même temps des électrodes pour y mesurer des courants électriques, d’autres pour m’envoyer des décharges. J’étais aussi le cobaye de tous les stimuli jusqu’à ce que je sois libérée à la fin de la guerre, clocharde et mendiante dans les rues de Tananarive.
Et une phrase m’obsédait : je ne ressens aucune émotion. Je hurlais au ciel : vous trouvez que je ne ressens aucune émotion ? Vous avez ce culot-là ? Et en moi-même, je me murmurais que je ne ressentais aucune émotion et j’étais effondré, annihilé, réifié comme mon double dans le Tyrol Autrichien ou ma précédente enveloppe humaine à Madagascar.
Les étoiles qui avaient bougé se remirent à se mouvoir, à quitter l’axe de ma vue où elles s’étaient regroupées pour retrouver leur positions initiale. Le jour se leva. Les étoiles disparurent. A droite, je vis d’épaisses fumées. L’incendie semblait gigantesque. Ces fumées se transformèrent bientôt en nuages qui prirent la forme d’un Airbus géant qui s’avançait doucement vers moi. Je me dis que le Joueur était à bord et qu’il venait enfin me chercher. Arrivé à ma hauteur, il disparut de ma vue.
Il était huit heures. Des clients de l’hôtel descendaient à la cafeteria. J’étais sur le parking. Et j’entendis que j’avais gagné le plus grand round de l’histoire secrète de l’humanité. Jamais les adversaires n’avaient concentré autant de moyens techniques pour me déstabiliser mais mon discours les fit capituler. Le champ était libre pour crier victoire. Finalement, c’était moi, en résistant, qui avait fait fuir les forces du mal. N’importe quel homme ou femme que je rencontrerais m’en serait désormais reconnaissant et me conduirait à Versailles où le Joueur le « roi-martien-soleil au service de tous » voulait me retrouver. Il suffisait que je demande à cet homme qui verrouillait la portière de sa berline de m’y conduire. Je n’osais pas. J’interrogeais les signes qui me dirent : allez, un peu de courage ! Je m’approchai, bafouillai :
Excusez-moi… Vous n’êtes pas libre maintenant pour me conduire à Versailles ?
Non pas vraiment. Désolé.
Je m’étais encore planté. J’entrai dans la cafeteria. J’expliquai à la patronne que j’avais été grugé par la machine, que j’avais dormi dehors, qu’il était hors de question que je paye le petit déjeuner. Elle me regarda par en dessous, me demanda ma carte bleue, m’autorisa à manger. Je regardai un poster de la demeure des papes d’Avignon : je me dis que j’allais être reçu là-bas, puis une image de Châteauneuf du pape : c’est bien nous boirons le Joueur et moi du bon vin. C’était peut-être comme ça la fin.
Un phénomène étrange se produisit. Au cours de la nuit, j’avais perdu mes verres de contact pendant mon discours-fleuve et là, j’avais retrouvé une vue parfaite. Ma myopie avait été soignée ! De nouveaux signes me dirent que cette fois-ci c’était fini, je pouvais jeter mon sac par exemple dehors sur la pelouse, si ça m’était égal. Je ne me fis pas prier : il avait été tellement lourd.
La patronne revient avec un regard franchement hostile. Elle me demanda de ramasser mon sac. Je refusai. Des voix me dirent que je pouvais me permettre de la renvoyer chier. Elle se coucherait facilement. C’est ce que fis et elle disparut à nouveau.
Pendant le café, d’autres signes me dirent que je ne retournerai jamais en vacances sur les plages de Nantes que j’avais trop usées. Je n’irais pas non plus dans les pays d’Afrique de l’Ouest producteur de café, que je ne boirai plus de café, que ce breuvage était un ennemi pour moi. J’étais désagréablement troublé par ces révélations et me dis : attendons qu’on me le dise en voix propre. C’était tout de même curieux.
D’autres signes me dirent que depuis ce matin, la gratuité s’était installée sur la terre. Les clients qui m’entouraient en tiraient bénéfice sans surprise ni joie extrême en vivant cela comme si elle avait existé depuis longtemps. En revanche, le fait que je sois encore détenteur d’une carte bancaire indiquait que j’appartenais au clan des voyous que la vague paradisiaque avait exclu de ses titulaires. Le fait de l’avoir présentée à la patronne et de l’avoir presque engueulée signait mon appartenance aux clans à certains délinquants « en col blanc » ou trop salauds exclus de l’Eden.
Elle revint et me regarda d’un air carrément suspicieux. Me demanda de me calmer et de ramasser mon sac. Je refusai. Des gendarmes se présentèrent, me demandèrent de les suivre. Je crus que c’était une escorte officielle pour m’emmener à Versailles. C’est à ce moment-là que je ne pus m’empêcher de réintégrer le Chanteur comme complément amoureux de notre dispositif cosmique avec le Joueur. Et j’étais gêné car je voyais mal la vie à trois dans ce château _qui ne me convenait pas d’ailleurs car j’étais résolument républicain et partisan des visites publiques de l’édifice_ et surtout j’éprouvai des difficultés à imaginer la place que le Chanteur occuperait. J’étais décidément accroché au Joueur. Ma tête fut saisie d’un violent tremblement qui la fit monter vers le soleil depuis le fourgon et je fus surpris de voir distinctement une tête de mort à l’intérieur de l’astre qui n’avait jamais été gros et pâle à cet instant-là. Je fus pris de panique et pensai à mes origines nantaises, au soleil qui clama sa colère contre la traite des Noirs et peut-être son désaccord avec l’idée d’ajouter le Chanteur au Joueur.
On me fit attendre dans les locaux de la gendarmerie. Le soleil devint plus puissant. Mon visage se mit à sa hauteur par la procédure du guidage automatique qui ne me fit pas en décoller. J’enlevais mes vêtements du haut et me caressai les seins quand l’adjudant arriva. Il protesta, demanda de me rhabiller et procéda à un interrogatoire d’identité.
Les pandores m’emmenèrent aux Urgences. J’attendis dans une salle blanche où pendirent des fils électriques dénudés. J’imaginai que me mère avait été torturée à l’électricité pendant la deuxième guerre et je me tordais de douleur car je revivais la scène toutes les trois minutes. Je pensais que la République voulait m’ausculter avant de me conduire à Versailles. Un médecin me posa des questions banales qui n’avaient rien à voir avec des désordres mentaux.
Les gendarmes me firent à nouveau monter dans leur fourgon. A ma question, ils me confirmèrent qu’ils ne m’emmenaient pas à Versailles, cette foutue destination qui m’emmerdait en même temps car je n’aimais pas les monarchies.
Le véhicule entra sous un porche où s’enfilaient une série de bâtiments bas à l’intérieur d’une forêt de pins. Je crus reconnaitre l’endroit alors que je n’y étais jamais allé. Cette familiarité me fit penser que j’avais bien connu l’endroit dans une vie antérieure.
Des infirmières me réceptionnèrent. Un médecin au visage avenant m’accueillit. Lui aussi, je crus l’avoir déjà rencontré dans le passé. Il n’était pas de la Maison Blanche de Paris. Mais cette fois encore, je me retrouvai à l’hôpital psychiatrique.

