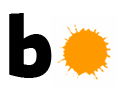



J’avais eu tout le temps de méditer. J’avais dormi deux heures. Au réveil, je regardai ce journal hideux. Je crus qu’on avait tiré dix exemplaires copiant à l’identique la maquette, titraille et typo. Je ne voyais pas cela se faire sans le concours du journal et ça me rendit passablement agité. Ce faux journal avait été fabriqué pour moi avec des complicités internes dans le seul but que je le lise à cet endroit précis dans des circonstances aussi troublantes. Et le poison semblait vouloir me démontrer que le journal désirait me donner une leçon : dans ce pays enclavé, proche de la guerre, loin de tout, voilà ce que pouvait devenir Le Monde s’il était écrit par un journaliste comme moi, c’està-dire un fscho caché, un rouge-brun qui s’ignorait, un de ceux en gestation, dont on avait capté les non-dits, les silences, sans doute des formulations subliminales, des architectures d’écritures inconscientes. Ils avaient l’air tellement intelligents en haut de la pyramide, sûrs de leurs conscience et puissants dans leur manière de mettre à terre. A nouveau, je fus saisi par une peur inimaginable. Jamais je ne m’étais senti aussi seul. J’étouffais sous une chaleur accablante. Je n’avais plus de Coca. Je me déshydratais.
Le journal avait l’habitude de demander plus, toujours plus à ses journalistes. J’en réclamais davantage. Mais là, quelque chose s’était effondré. J’avais beau connaître mes limites en matière technique, j’étais sûr que cet exemplaire hideux avait été fabriqué à l’intérieur de la maison. Je savais que celle-ci pouvait être capable de cynisme, de jouer aussi. Je savais que le journal adorait mon travail mais pouvait tout aussi bien vouloir m’éliminer comme dans un process kafkaïen. C’était Georges, l’adulé du siège, -aucun journaliste n’était revenu de Podgorica sans en dresser des louanges-, ce même Georges espion empoisonneur qui m’avait tendu cet exemplaire du journal et invité à le lire. Un orage d’une violence et d’une puissance que je n’avais encore connu dans ma vie, éclata. Et moi dans mon infinie solitude, lâché de partout, je ne pus m’empêcher de penser à une colère du destin, du cosmos, de Dieu. C’était évident. Il m’adressait un signe, effrayait les autres. Il y avait quelque chose de vrai tant la coïncidence fut frappante, comme une révolte ultime de la nature, un présage impressionnant comme un bombardement d’une échelle jamais égalée.
Les éclairs me ravigorèrent. Ce n’était pas moi qui étais devenu fou : tout se détraquait autour de moi. J’étais en colère. Contre ce journal falsifié. Contre le fait que ce Georges, si compromis, m’ait été présenté comme l’un des meilleurs collaborateurs du journal. Je décidai d’appeler Paris et de demander de franches explications.
![]() Allo ? Oui C’est moi. C’est quoi cette édition du 4 septembre ? Je l’ai lu hier, on aurait dit un journal d’extrême-droite.
Allo ? Oui C’est moi. C’est quoi cette édition du 4 septembre ? Je l’ai lu hier, on aurait dit un journal d’extrême-droite.
![]() De quoi tu parles ? me demanda un des directeurs adjoints de la direction et « ami » par ailleurs.
De quoi tu parles ? me demanda un des directeurs adjoints de la direction et « ami » par ailleurs.
![]() L’article sur la génétique. C’était nazi !
L’article sur la génétique. C’était nazi !
![]() Tu rigoles. C’est moi qui l’ai relu. Il était correct. J’ai fait extrêmement attention car c’était casse-gueule. Y avait rien de nazi.
Tu rigoles. C’est moi qui l’ai relu. Il était correct. J’ai fait extrêmement attention car c’était casse-gueule. Y avait rien de nazi.
![]() Ben dis donc ! Je t’assure, c’était on ne peut plus facho comme… le papier sur l’immigration.
Ben dis donc ! Je t’assure, c’était on ne peut plus facho comme… le papier sur l’immigration.
![]() T’es sûr que ça va bien ? Tu as vu Georges ?
T’es sûr que ça va bien ? Tu as vu Georges ?
L’évocation de ce prénom par un de ceux qui m’avait toujours sidéré par son art de manier le double jeu me fit exploser de colère. Je racontai tout et je répétai qu’il ne fallait pas se foutre de ma gueule. Il était silencieux, me demanda de rentrer immédiatement à Paris, ajoutai que j’avais perdu la tête.
![]() Ça va pas bien, ça va pas bien. A Paris tu seras mieux.
Ça va pas bien, ça va pas bien. A Paris tu seras mieux.
Et je me dis que le poison ajouté à la personnalité de mon interlocuteur n’allait pas dissiper le clivage qui s’était désormais installé en moi. Je sentis d’ailleurs ma tête tourner. Mais je lâchai l’éponge pour Belgrade. Georges, les espions, Podgorica me faisaient peur. Je n’étais pas taillé pour être à la fois empoisonné, avoir un doute sur le journal, me sentir harcelé par des polices secrètes et mener comme si de rien n’était mon travail d’interview des gens en sachant désormais que les lois du hasard étaient trafiquées.
J’attendais dans l’appartement la soif à la gorge. Georges arriva, me dit qu’il avait eu le journal au téléphone et qu’il devait me faire revenir à Dubrovnik pour prendre le premier avion pour Paris. La mission était annulée. J’acquiesçai sans le regarder. J’aurais dû le passer à la question mais le poison agissait, me paniquait et je craignis une arrestation par ses hommes. Je n’avais plus confiance en lui, je voulais absolument assurer la sécurité du retour, du passage de la frontière du Monténégro à la Croatie pour atteindre un aéroport international. De toute façon, j’avais l’intuition que si je l’interrogeais, il aurait chiqué c’est-à-dire en langage de flic, il aurait nié jusqu’à l’évidence : le poison, les agents secrets, les insinuations, son agressivité même s’il n’avait rien modifié de ce côté-là. Il était furieux, remonté comme une pendule.
Ses yeux voulaient me tuer. Il me fit monter dans une voiture jusqu’à un fleuve. A bord d’un bac qui le traversait, il me dévisageait avec une moue pour le livre de Salinger que je tenais à la main :
![]() Tu es vraiment fier de lire une merde comme ça ?
Tu es vraiment fier de lire une merde comme ça ?
Je voulais tellement assurer mon arrivée à bon port que je choisis de ne pas répondre malgré l’envie tenace de défendre mon admiration pour Salinger. Je baissais même des yeux et éprouvai un sentiment mêlée de honte et d’humiliation car j’avais l’impression d’être un otage face à un bourreau qui pouvait se permettre de tout dire.
A l’arrivés à la frontière coate, il me lança :
![]() Tu es vraiment fier de ce que ton père a fait pendant la seconde guerre mondiale ? Tu veux que je te dise : tu me dégoûtes.
Tu es vraiment fier de ce que ton père a fait pendant la seconde guerre mondiale ? Tu veux que je te dise : tu me dégoûtes.
Il me quitta ainsi en me jetant dans un grand trouble. Jusqu’à preuve du contraire, mon père avait vécu la guerre comme de nombreux jeunes Français de 14 ans dans un sentiment farouchement anti-nazi sans ayant pu s’engager dans la Résistance. Georges et les services secrets voulaient-ils le faire passer pour un collabo ? Savaient-ils des choses ?

