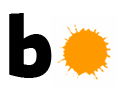



Je croyais que c’était bien d’aller à l’HP. C’est ce que m’avait expliqué l’ambulancier.
Ce sera la campagne et vous verrez vous serez bien.
En traversant la Seine et Marne, je vis beaucoup de jardins, de fleurs blanches, de lapins. Je trouvais ça beau.
Arrivé dans l’un des multiples pavillons de l’hôpital, je pris possession de ma chambre où étaient inscrites au crayon une multitude d’équations avec des racines carré qui se baladaient dans tous les sens. Je dormis.
Ensuite, euphorique, j’avais besoin de dire à toutes les femmes internées et aux infirmières qu’elles étaient belles. Je dessinais des fleurs sur les murs et on me dit que c’était interdit.
Le plus dur c’était l’impossibilité de sortir du pavillon. Il y avait beaucoup de bruit de clés. Parfois les infirmiers courraient en groupe : il y avait une urgence. J’avais remarqué un dèpe parmi eux : il avait des yeux de biches qui avait joué, en une seconde, du regard de connivence avec moi tout en le censurant. J’avais repéré un médecin maghrébin. Il devint mon psychiatre, le genre sympa et souriant. Il avait un accent de bledar.
Le pavillon ressemblait à une immense garderie avec sa salle commune, le réfectoire et le salon de télévision au rez-de-chaussée, les chambres individuelles à l’étage.
Maria était souvent enfermée dans la sienne. Elle hurlait et frappait constamment à sa porte et des infirmières allaient l’engueuler pour que ça cesse. Il est vrai que c’était pénible, je me tordais de douleur à entendre ses cris car ils ruisselaient de souffrance, celle, brute, qu’on a au plus profond de soi et qui vous enferme, l’insupportable. Elle n’en pouvait plus mais on ne savait pas de quoi car souvent Maria perdait l’usage de la parole. Elle avait de grands yeux et la bouche tordue d’où coulaient des filets de salive. Et je crois que je n’étais pas le seul à souffrir pour elle. Les malades, le personnel soignant étaient affectés par ses appels au secours mais personne ne comprenait ce que Maria voulait, elle non plus peut-être. Elle était murée dans une seule expression : le cri. Elle avait ses heures de Maria-bête au sens animal, tellement habitée par cette condition qu’on avait du mal à imaginer qu’elle en avait connu une autre. On aurait très bien pu la représenter dans une jungle hurlant à la mort, c’était ce qu’elle nous disait : les mêmes vibrations de celle qui sentait la vie s’échapper et en éprouvait la trouille, une révolte immense où elle menait jusqu’au bout le dernier combat pour se faire entendre, comme le son qui s’échappait de sa bouche devait lui prouver qu’elle était animée par le souffle du hurlement la sortant de l’apnée, de l’arrêt, du meurtre qu’elle voyait arriver. Ses yeux étaient effrayés puis mélancoliques et peinés quand tout s’était arrêté.
Un jour, elle portait une robe de velours bordeaux. Elle était belle, le visage soigneusement dessiné, un corps qui retrouvait une grâce quand elle se redressait car elle marchait cassée en deux. Et j’étais fier qu’elle parvienne à danser avec moi. Je l’avais invitée sur un coup de tête, nous n’étions que tous les deux devant les autres, je fredonnais un air, voulus l’entraîner dans une valse mais celle-ci s’était transformée en de grands pas qui nous soulageaient l’un et l’autre, nous regardant dans les yeux, en nous souriant, presque comme des amoureux.
Je parvenais à la calmer plusieurs fois comme ça.
Une autre femme s’était enchaînée imaginairement à un radiateur. Elle ne voulait jamais le quitter même pour aller manger. Une autre marchait comme si elle voyait devant elle le Christ. Elle portait une grande croix en bois et elle écarquillait les yeux, lui parlait comme on parle à un messie et lui racontait toute sa douleur aussi.
Du salon télé, on entendait toujours la femme de ménage gueuler :
M Bigentsein faut arrêter. C’est pas vrai ça.
M Bigenstein était un grand et vieux monsieur obèse qui n’arrêtait pas de se branler en regardant TF1 constamment allumé. C’était horrible à voir, tout le monde désertait le salon télé, et M Bigenstein en mettait partout et l’odeur était prégnante.
M Larbi, lui, aimait chier dans le même salon télé si bien qu’on avait vraiment envie de dégueuler. Et quand il allait aux toilettes, il faisait à côté si bien qu’on ne pouvait pas y aller. C’était gênant. Il n’y avait jamais assez de personnel pour nettoyer. Les infirmières, tout juste assez nombreuses pour que le bordel tienne en équilibre, disaient que c’était vraiment pas normal cette compression du personnel dans les HP, que l’opinion publique ne pouvait s’en rendre compte, il n’y avait que les malades et leurs familles.
Au bout d’un certain temps, on avait des heures de sortie et c’était bien même si l’enceinte était trop grande pour se balader partout : ils avaient constitué des secteurs et chacun d’entre eux correspondait à un arrondissement de Paris. Il y avait quelques arbres mais surtout d’immenses pelouses avec des flèches et plans partout pour ne pas se paumer.
J’aimais aller à la cafeteria. Il y avait Laurent. Il était malade et employé comme serveur. Il souriait tout le temps. Il était beau avec ses mèches, un côté Benoît Magimel à 25 ans, très Titi parisien. Je ne savais pas que c’était un gigolo. J’étais tellement accro que je suivais tous ses mouvements.
Nous avons fini par faire connaissance. Il m’a dit qu’il avait perdu sa mère. Le chagrin l’avait conduit ici, mais ça, je l’ai déduit. Il semblait prêt à faire les quatre-cents coups, surtout pour aller fumer des pétard avec son copain Désiré l’Antillais, une bête de beauté. Nous étions tous les trois dans un fourré à tirer sur le bédot et eux, me paluchait des patins dorés. Désiré sortait des broussailles et tournait sur lui-même, les bras en croix, en souriant au ciel gris et menaçant :
Je suis le roi du monde ! Je suis le roi du monde.
Et nous rigolions.
Laurent était toujours prêt pour les bédots, les patins et que je lui touche la bite et tout le reste qui s’en suit. Désiré n’était pas le dernier. Finalement, j’avais mon petit havre de tranquillité ici sauf un détail qui me perturbait : les médicaments me faisaient sentir un décalage entre le moment de la jouissance et de l’éjaculation. Mon psychiatre le blédard éclata de rire quand je m’en enquis auprès de lui et me promit que ce ne serait que mieux lorsque j’aurai arrêté de les prendre, surtout le cachet vert pomme, principal responsable de tous ces désagréments.
Pour consulter le blog depuis son premier épidode : http://ballondumondial.blogspot.com/

