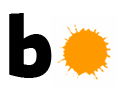




Comment définiriez-vous le journalisme d’investigation ?
Edwy Plenel : En général, la réponse classique qui est faite par la profession, c’est que « journalisme d’investigation » ne veut rien dire. C’est un pléonasme. Tout journalisme est d’investigation. Ordinairement, je préfère parler de « journalisme d’enquête », car le terme « investigation » est un anglicisme. Le journalisme d’enquête, c’est aller à la recherche des réalités, et ne pas considérer qu’elles nous viennent. L’enquête, au sens général, c’est d’abord ça. Après il y a évidemment l’enquête au cœur d’un domaine fermé. Souvent, on applique cela aux affaires d’état et aux secrets d’état, aux affaires policières et financières. Aujourd’hui, nous sommes face à un journalisme passif, de compte-rendu. Pas par manque de volonté, mais parce que l’agenda est là, parce qu’il nous envahit et nous piège. Un bon journal est un journal qui doit bousculer, faire réagir.
Dans quel domaine le journalisme d’enquête joue-t-il son rôle le plus important ?
E.P. : Aujourd’hui, l’univers le plus difficile et le plus essentiel de l’investigation, c’est l’univers économique. C’est un univers plus opaque qu’ailleurs, un mélange de puissance liée à la « financiarisation » de l’économie et de culture française où au fond tout le monde se protège avec un certain côté incestueux. Il y a vraiment une nécessité d’aller au cœur de ce domaine pour exercer un véritable contre-pouvoir. Cela dit, le journalisme d’enquête recoupe toutes sortes de domaines. Par exemple, je pense qu’un journalisme d’enquête sur la société française est nécessaire. Au moment des émeutes de 2005, on a vu comment une partie de la presse nationale ne connaissait pas son territoire. Nous n’étions pas capables de prendre le RER, d’aller au-delà du périphérique. Se posait même la question de se rendre sur place avec un fixeur, comme en Irak. Des journalistes suisses de L’Hebdo sont venus nous faire une petite leçon en nous racontant la société que nous, journalistes français, n’avons pas été capables de raconter.
Selon vous, faire de l’enquête, c’est donc avant tout pratiquer un journalisme de terrain au quotidien…
E.P. : Pour moi, la bonne enquête, c’est une continuité, celle du rubricard qui travaille. Prenons l’exemple de Seymour Hersh, journaliste au New Yorker. C’est un rubricard. Il fait le pentagone depuis les années 60. Il suit les colonels, les officiers, le monde militaire. Ses sources, sur l’administration Bush, c’est des militaires. C’est un porc-épic, c’est un type sauvage. La vérité sur les armes de destruction massive, c’est lui. La révélation du massacre de My-lai, au Vietnam, c’était déjà lui. Lorsqu’en 1980, j’arrive au Monde, je suis un rubricard. Et puis à l’occasion d’un été où il y avait des attentats, il y a eu besoin de renforts. On me propose la rubrique police. C’est ce travail de rubricard qui m’a amené à tomber sur des secrets d’état. D’ailleurs, il y a beaucoup d’endroits, comme l’Assemblée Nationale ou le Parlement, qui ont été délaissés ces derniers temps par les rubricards. Ce sont des mines d’infos. Dans un journal comme Le Monde, il n’y a plus qu’un rubricard pour les deux assemblées. Aujourd’hui, on vous présente comme des révélations des infos issues de dossiers judiciaires, de procès verbaux. Pourtant, en amont de la justice, il y a la police, les policiers de terrain. C’est là qu’il faut aller, dans les congrès de syndicats de police, pour nouer des contacts. Cela permet de se dire que l’on est pas otage d’un avocat qui donne accès au dossier, que l’on a d’autres points de vue sur l’enquête.
L’investigation journalistique, n’est-ce pas également entretenir un réseau de sources fiables, posséder un carnet d’adresses fourni ?
E.P. : Le journaliste n’existe pas sans ses sources. C’est pour cela que la protection des sources est un élément essentiel du rôle démocratique des journalistes. Il faut absolument renforcer la protection des sources. Nous ne sommes pas des auxiliaires de justice, encore moins des auxiliaires de police, et certainement pas des auxiliaires des services de renseignement. Nous ne sommes pas des indicateurs. Ce qui m’inquiète, c’est que certains magistrats et confrères oublient ces règles. Il faut rappeler aux magistrats et aux politiques que nous, journalistes en démocratie, devons avoir le droit de rencontrer des gens pas fréquentables. On doit avoir le droit de fréquenter des bandits, de rencontrer des voyous. On ne peut pas demander à tout le monde sa légion d’honneur et son certificat de baptême pour en faire une bonne source. En ce qui concerne l’information sensible, les sources sont vraiment primordiales. Le crédit que la source aura en vous doit être un crédit sur votre travail. Sinon, c’est qu’il y a autre chose que cette relation professionnelle au point de départ.

Lorsque l’enquête dure plusieurs mois, une certaine connivence s’installe forcément entre le journaliste et sa source. N’est-ce pas dangereux pour l’information ?
E.P. : Les sources, ça s’éduque. Dans l’affaire des Irlandais de Vincennes, quand le commandant Jean-Michel Beau, qui avait un peu couvert les irrégularités, me rencontre et me dit : « bonjour Edwy », je sais qu’il me respecte, même si j’ai publié des informations qui n’ont pas été bonnes pour lui. Il me respecte pour le sérieux de ces informations. D’autre part, si une source amie commence à vous intoxiquer, à vous balader, vous ne devez plus avoir de contact avec elle. Du jour au lendemain, elle doit être rayée pour avoir trahi ce climat de confiance. Dans la relation de distance à une source, il peut arriver des accidents. Il m’est arrivé une fois de me retrouver dans une relation où un lien personnel a commencé à se nouer. C’était un policier. Elle a pu se nouer car ce policier n’a jamais usé de cette amitié pour peser sur ce que je faisais. Notre métier, c’est cet art là. Il faut être à la fois très près et très loin. Il faut gagner une confiance qui n’empêche pas la distance.
Pensez-vous qu’un retour au journalisme d’enquête soit nécessaire contre la passivité des rédactions ?
E.P. : On entend certains éditorialistes dire qu’ils ont un problème avec le journalisme d’investigation. Le journalisme que j’appelle « de gouvernement » est un journalisme de jugement, de commentaires, d’éditoriaux. Il peut-être très brillant, et je le respecte. Mais je dis juste que ce n’est pas le cœur de notre métier. Si on en fait la référence de notre métier, on oublie le b.a-ba. Revenons à notre travail. Notre première discipline est une discipline de vérification. Il faut se relire, vérifier, recouper, etc. Dans un monde surinformé, la question de la hiérarchie, du tri, de la pertinence, est également fondamentale. Aujourd’hui, même le mensonge peut arriver. Après le 11 septembre, la démocratie américaine y est tombée avec les armes de destructions massives. Elle s’est réveillée deux ans après grâce à ce journaliste du New Yorker, qui a sonné la fin de la récréation. Il a révélé Abou Ghraib, les tortures, etc. Aujourd’hui, tout cela est public. Deux ans après, le travail a donc été fait, mais entre-temps, les dégâts ont eu lieu, et ils sont incommensurables. Nous ne sommes pas à l’abri des manipulations. Le « suivisme » peut entraîner le fait qu’un mensonge fonctionne.
Peut-on lutter contre ce suivisme en favorisant un pluralisme dans la presse ?
E.P. : Le pluralisme de la presse, c’est de confronter les agendas. La présidence actuelle impose son agenda au pays. On a un président qui, tous les jours, a un événement. C’est un problème démocratique. Notre enjeu est là : la pluralité des agendas, et le rapport à la réalité de faits. Nous avons à reconquérir notre légitimité. Produire des vérités de fait, produire des informations, ça se travaille. Il faut aller sur le terrain, enquêter, trouver, vérifier, et recouper. Hiérarchiser, contextualiser. Un fait, il a une histoire, une profondeur, il n’est pas uniquement dans l’immédiat. Comprendre l’opacité des choses, c’est important. Commenter ce fait, discuter de ce fait, le critiquer, en débattre, émettre des jugements, ce n’est pas notre compétence. On peut le faire, et on le fait. Mais c’est la liberté d’expression de tout le monde. Les opinions, c’est une chose, et la vérité des faits, s’en est une autre. Dans ce métier, nous autres journalistes, devons trouver des informations qui dérangent nos propres opinions.

Sans une presse indépendante, le journalisme d’enquête peut-il réellement jouer son rôle ?
E.P. : La question de l’indépendance de l’information en France se pose. C’est aberrant de voir que les principaux acteurs de la presse – les industriels -, qui possèdent les principaux groupes d’information, n’ont pas l’information comme premier souci. Leur premier souci, c’est l’industrie de l’armement, le commerce en Afrique, l’aviation. Mais il n’est pas seulement question de savoir qui contrôle économiquement les journaux. Ces acteurs économiques sont tous très liés, intimement, à l’homme le plus puissant de France. Notre système présidentialiste ramène tout à une seule personne. C’est contradictoire avec la liberté, et avec l’indépendance de l’information.
L’investigation possède également sa part d’ombre. On pense notamment manipulations qui ont suivi les révélations de l’affaire Clearstream…
E.P. : J’étais le directeur de la rédaction du Monde lorsque la première affaire Clearstream a démarré, en 2001. Après quelques vérifications, j’ai refusé de publier les bonnes feuilles de l’enquête. Si je les publiais, j’en étais autant responsable que son éditeur. J’ai dit que cette enquête ne tenait pas la route. Selon moi, elle comportait des erreurs. Elle était trop confuse, trop personnelle, contradictoire. Quelques vérifications élémentaires sur des points précis manquaient. Une enquête c’est comme un château de cartes : s’il en manque une, tout peut s’écrouler. Je n’ai pas cru à l’idée qu’il y ait un établissement qui soit la boîte noire de la finance corrompue. Et parallèlement, cette enquête ne le démontrait pas. Aucun grand journal s’occupant de la finance internationale, aucun enquêteur du Financial Time, du Wall Street Journal, de The Economist…n’a porté crédit à la première affaire Clearstream. Il n’y a qu’en France qu’elle existe. C’est, hélas, le fantasme journalistique de départ qui a permis à la deuxième affaire Clearstream de s’épanouir. C’est une bonne chose de se battre contre la corruption, les circuits d’argent opaque. Mais à travers ce travail, on a cherché la réalité de ses convictions. Résultat, c’est la vérité qui a été tordue. Ce que l’on ne peut prouver, sourcer, ou démontrer factuellement n’existe pas dans notre métier.
Le mythe du journaliste d’investigation est-il toujours présent au sein de la profession ?
E.P. : Je défends, je revendique ce journalisme d’investigation qui est « démonisé » par ce que j’appelle le journalisme de gouvernement, de pouvoir. Mais je ne le fantasme pas pour autant. Notre travail, c’est d’abord un bon carnet d’adresses, une bonne rigueur, une relation de confiance – et non pas de servilité – avec nos sources, en se faisant respecter et en les respectant. La clé de l’investigation, c’est d’être soutenu. Quand on sort une nouvelle qui dérange, qui bouscule une entreprise, un parti politique, une collectivité quelle qu’elle soit, c’est normal que l’on prenne des coups. Il ne faut pas croire que l’on puisse avoir le beurre et l’argent du beurre. Nous sommes un apporteur de mauvaises nouvelles. J’ai toujours dit que le journaliste qui revendique le droit d’aller chercher une information difficile, doit accepter d’avoir la morale d’un boxeur, a qui on apprend à encaisser avant de lui apprendre à donner des coups. Il faut apprendre à encaisser.
Propos recueillis à Lyon les 18 février et 20 mars 2008.
(Photos : Fabrice Catérini / http://www.flickr.com/photos/el_paparazzi/).
Lire ou relire sur Bakchich.info l’épisode précédent du blog de Benoit Pavan :
Voir aussi le blog professionnel de Benoit Pavan : http://benoitpavan.wordpress.com/

