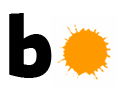


Gloomy Monday

C’est un joli nom Camarade. C’est le nom que nous lui avions donné depuis qu’il était entré dans nos vies, qu’il avait rangé dans nos maisons les mots d’Aragon, chanté l’amour qui fait perdre la raison, qui donne aux filles des regards de Sainte Vierge.
J’ai ce privilège, de me souvenir de la première fois où j’ai vu son visage aussi grand que mon écran de télé, de la première fois où j’ai entendu sa voix grave qui chantait vingt et cent, qui chantait des milliers dans des wagons plombés. Cette chanson résonnait dans mon programme d’histoire, j’ai fermé mes cahiers et j’ai écouté. Je l’ai regardé, comme si je buvais son visage.
D’autres ont le privilège de ne pas se souvenir, car de première fois il n’y a jamais eu. Car Jean Ferrat avait toujours été là.
C’est un joli nom Camarade. C’est le nom qu’il s’était donné en marchant aux côtés du PCF, en chantant les luttes sociales, en rythmant les manifs et les fêtes populaires.
Ses chansons étaient faites pour dire un monde où l’on n’est pas toujours du côté du plus fort. Mais être compagnon de route, fidèle à ses convictions, ne voulait pas dire applaudir des injures, approuver des massacres. En 1979, il a refusé d’avaler une nouvelle couleuvre et a fait son propre bilan de ce qu’aura coûté le stalinisme à l’histoire de ce monde. Il a dénoncé une caricature de socialisme tout en gardant chevillé au coeur cet idéal qui le faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd’hui.
Chanteur engagé, poète militant, il se tenait sur le front de toutes les injustices, écrivait comme on manifeste, aimait avec la générosité des grandes idées. De Pablo Picasso à Pablo Neruda, de Fidel Castro aux yeux d’Elsa, des marins de Potemkine à Nuit et Brouillard. Ses chansons étaient des combats.
Combattre en chantant pour que le sang ne sèche pas en entrant dans l’histoire. A l’heure où il fallait twister les mots pour se faire entendre, il clamait les noms de Jean-Pierre, Natacha ou Samuel qui avaient déchiré la nuit de leurs ongles battants.
Combattre les guerres coloniales en se faisant la voix de ceux qui s’allongeaient sur les rails pour arrêter les trains.
Combattre aux côtés des Chiliens disloqués à coup d’interrogatoires, de carotte et de bâton, de plongeon dans la baignoire, de gégène et de tison dans une chanson encore vibrante d’actualité, "Le bruit des bottes".
Combattre aux côté des femmes dont les siècles d’infini servage pèsent encore lourd sur la terre.
Lui qui raillait les jeunes Républicains-Indépendants dont on avait perdu la filiation humaine à partir de l’homo sapiens de Saint-Trop’, aurait tout aussi pu disséquer les jeunes populaires à la lippe daubique.
Mais le monde sera beau, il l’a affirmé, il a signé.
Il chantait sa France, celle qui avait laissé sur sa lèvre sèche un goût de bonheur. Celle où les mômes ne sont pas des starlettes mais travaillent en usine, où les vieux ont l’âme noueuse comme un pied de vigne, où l’air a des odeurs de thym et de bruyère.
Il a bouclé ses valises avant qu’il ne vienne vraiment, le temps des cerises. Mais c’est comme si nous étions tout près de le voir fleurir enfin. Il a bouclé ses valises, trop tôt.
Monsieur Ferrat, j’ai pas fini mon rêve.

