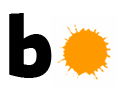


Gloomy Monday

Encore un vrai gloomy Monday, un lundi de chagrin où la vie s’arrête pour les gens comme vous et moi, le temps de soupirer, le temps d’être un peu triste, le temps d’avoir l’impression de perdre un peu de soi-même lorsque quelqu’un de célèbre meurt, quelqu’un qui vous a accompagné un petit bout de chemin. La nouvelle du week-end, c’est que Dennis Hopper a cassé sa pipe et qu’il s’est cassé au paradis ou en enfer, je l’imagine, avec son rire sardonique.
Je ne vais pas m’étendre sur le degré d’intimité que je partageais avec cette figure underground, lumineuse, déjantée, tutélaire, ambivalente, polyvalente, controversante du cinéma américain, ni ce qu’il représentait dans ma vie. D’ailleurs, je ne me souviens plus dans quel film ni à quel âge je l’ai vu la première fois. Tous simplement, Dennis Hopper est de ces acteurs dont il suffit qu’ils apparaissent au générique d’un film, peu importe lequel, pour que j’ai envie de le voir, avec Christopher Walken, Robert Duvall, Sean Penn, Harvey Keitel, John Savage, Tim Roth, mes icônes personnelles.
Je vois en Dennis Hopper un diamant noir. Beau, diaphane, presque transparent, inexistant à ses débuts, sa fascination pour James Dean me fascine. Pour moi, elle ne relève pas seulement de la simple admiration pour un acteur doué, elle ne relève pas seulement d’une certaine forme de gémellité. J’ai également l’impression que Dennis Hopper avait trouvé la fêlure intime, les reflets que le miroir de Dean lui renvoyait en éclats brisés. Et j’ai l’intime conviction, que lorsque James Dean est mort, Hopper s’est senti investi de cette fêlure et qu’elle l’a habité sans jamais réussir à le tuer.
Je n’ai pas envie de redire tout ce qui a déjà été dit et bien dit sur Dennis Hopper. Je l’aimais surtout pour ses rôles de méchants, je l’aimais pour tous ces seconds rôles, ces rôles de psychopathes, de brutes épaisses qu’il acceptait dès qu’on les lui proposait et sur lesquels s’affligent aujourd’hui les exégètes. Cela lui permettait de cultiver une présence, d’être accessible. J’avais aimé son passage dans la première saison de 24 heures chrono. Cela avait été une réelle délectation de le découvrir dans les derniers épisodes, sa présence en était toujours une, avec cette impression de me passer la langue sur les lèvres. C’est l’effet qu’il me fait.
C’est également l’effet que m’a fait l’émission Eclectik sur France-Inter que j’ai réécoutée aujourd’hui en podscast durant laquelle il parlait de son bras de fer avec Henry Hathaway, de son quasi-dégoût pour John Wayne et tout ce qu’il représentait (« L’Actor’ Studio, nous ne voulons pas de cette merde. »), de sa descente aux enfers de la drogue et de l’alcool (« J’ai l’impression d’être allé aussi loin que possible. Après il faut revenir. ») . Et l’entendre paraphraser Maria Rainer Rilke dans Lettres à un jeune poète : « On est un artiste que si, au point le plus bas, à la question : si on t’empêche de créer, en mourras-tu ? , on répond : oui et qu’il n’y a rien d’autre à faire. »
Il a eu la grâce d’embellir en vieillissant et de continuer à irradier de cette lumière devenue noire.
Easy Rider restera à coup sûr son coup de maître, son chef-d’œuvre personnel avant d’être une œuvre cinématographique majeure, à qui il avait réussi à faire dire l’essentiel de son urgence et de son inaltérable soif de s’imprimer dans un mouvement qui convertit la vie en art. Disséqué, expliqué, analysé, le film n’arrive toujours pas à vieillir et soulève chez les adolescents qui le découvrent encore aujourd’hui un vent de tempête, un nuage de révolte, comme le résument excellement les paroles de Born to be wild de Steppenwolf.
Fire all of your guns at once
And explode into space
Like a true nature’s child
We were born, born to be wild
We can climb so high
I never wanna die
Pour s’en convaincre, il suffit juste de regarder les premières minutes du film.

