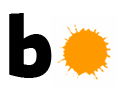



Certains, avec Hegel, disent que la liberté est une raison d’agir, ou plutôt que c’est la raison qui agit. Ce n’est pas l’extérieur, les évènements ou la contingence qui décident, c’est le moi profond. Vous me direz, qu’est ce que le moi ? Un vrai barnum ! Existe-t-il un véritable libre arbitre, puisque nous sommes non seulement l’addition de nos contradictions ; mais aussi celles de notre histoire : enfance, éducations, traumatismes de la vie. Pourtant, à un moment de la vie, il est aussi possible à un homme de dire « non » plutôt, que dire « oui ». Même sous la menace, il arrive donc à ces hommes et ces femmes de formuler la bonne réponse, le « oui » ou le « non » : celle qui défend leur honneur et justement leur liberté ; alors qu’ils ne sont pas nés des héros.
Pourquoi cette entêtement dans la volonté ? Parce que la liberté est un sport de combat, et qu’ils l’ont pratiqué à l’école, en famille, dans une association ou un parti. Une gymnastique permanente qui fait que, même si vous n’avez pas le courage de Guy Môquet, vous dite le « oui » ou le « nom » simplement parce qu’il colle à votre éthique. Une réponse qui, au choix, vous condamne à la mise au placard, au licenciement, à la prison ou à la mort. Comme si trahir ne faisait pas partie de votre choix. Dans ce cas, celui de situations extrêmes, rares pour nous mais courantes dans un monde toujours fou, la liberté s’exprime car elle s’appuie sur un corpus de principes fondamentaux qui sont ses balises. Quitte à paraitre banal, ceux d’égalité et de fraternité me semblent suffisant pour balayer tout le champ du possible : un monde d’égalité et de fraternité sera forcément libre. Un monde libre sera obligatoirement égalitaire et fraternel.Kant baptise « volonté objective » cette liberté née du devoir, le fait qu’on ne peut sans plus jamais se regarder dans le miroir, trahir son origine sociale ou son engagement philosophique. Rousseau dans son « Contrat social » évoque une liberté née d’un parcours accomplit au sein d’un « labyrinthe du politique ». Comme s’il existait, pour parler comme Sartre, un chemin de la liberté sur lequel on en fait l’apprentissage.
Des linguistes comme Husserl, et ceux de l’école d’Oxford, se sont penchés sur le poids que le mot liberté a dans le langage courant. Leurs études montrent que, de façon triviale, liberté se conjugue avec agir. Hélas, au fil du temps, le sens du mot qui désignait une action politique, syndicale ou militante, exprime principalement aujourd’hui un « Je fais ce que je veux », c’est-à-dire un déni de l’autre, le triomphe de cette individualité est le trait social de plus marquant de notre époque, ultra libérale bien sûr, et corrompre le mot liberté en le mêlant au mot libéral est une perversion et du langage et de la réalité qu’il recouvre. Définitivement, c’est deux mots sont inconjugables.
La liberté d’agir est maintenant l’apanage d’une minorité, justement qualifiée d’agissante, qui, anachronique si on la mesure à l’audimat d’un journal télévisé, se bat au nom d’un humanisme universel. C’est la lutte désintéressée contre l’abus de la loi et du pouvoir du genre marquage par des êtres par leur ADN, lutte contre les décisions politiques mortifères, lutte qui vient en soutien des plus défavorisés. Face à cette liberté d’agir, la liberté de penser n’est pas en meilleure santé. La phrase cliché : « je dis ce que je veux parce que nous sommes en République » est, sans que personne n’y prenne garde, en train de devenir une assurance du passé. Il y a quelques mois un professeur qui, dans la gare de Marseille, contemplait des policiers harcelant un SDF, s’est écrié « Sarkozy je te vois ! », a été traduit devant un tribunal. Tout comme cet ouvrier du Mans ayant brandit une pancarte : « Casses-toi pov’con » au passage de Nicolas Sarkozy. Le délit d’outrage, naguère oublié, a été remis à la mode par des policiers et des juges. Et il n’est plus exact que « nous pouvons dire ce que nous voulons puisque nous sommes en République ». La République est devenue chasseuse de pensée et de mots.
Au printemps dernier une dizaine d’hommes et de femmes ont été emprisonnés, essentiellement pour avoir collectivement écrit, ou cautionné, un livre intitulé « L’Insurrection qui vient ». Il faut donc savoir qu’en 2009, écrire peut vous envoyer au cachot. Bientôt, qu’un chevalier de La Barre revienne, et on va l’enchaîner au prétexte qu’il n’a pas salué le bon prince ou la bonne pensée. Pour donner brièvement dans la cuistrerie, rappelons que la vision d’Hegel, dont je vous ai parlé, celle où la liberté de l’homme obéit à son histoire, a été revisitée par Kierkegaard et les existentialistes. Eux, ouvrent la porte à un « ou bien … ou bien », c’est-à-dire, en dépit du poids des acquis et des strates intimes de notre histoire, qu’il existe une possibilité de faire un vrai choix « existentiel » dans une « libre liberté ». Les théoriciens de l’anarchie, eux, évoquent non pas une liberté individuelle, mais une richesse partagée, un bien commun, une vertu collective rendant libre chacun d’entre nous. Autrement dit, l’individualisme à la mode, celui d’aujourd’hui, est exactement le contraire de l’anarchie, puisqu’il est la victoire de l’égoïsme sur la fraternité.
Je voudrais quitter le formalisme et la philosophie à deux sous, ce qui n’est pas vraiment mon rayon, pour continuer de vous parler de la liberté et de l’homme libre. Vous en parler cette fois par la critique d’un instrument qui mesurer cette liberté : la presse. Le plus crétin des universitaires qui étudient les médias, et ils sont nombreux, les crétins, a déjà remarqué que nous sommes passé d’une presse d’opinion à une presse de consommation. La gratuité de l’information, celle que le modèle politico-économique veut imposer, est un symbole à l’envers. Je m’explique. Naguère, la presse d’opinion était payante, acheter un journal était un acte militant… Pendant que la presse de consommation, celle du business est paradoxalement gratuite ou presque. Pourquoi ? Parce qu’en contrôlant l’écrit et le dire, les politiques et leurs amis marchands, si toutefois on peut distinguer les uns des autres, ont une double certitude : dégager « du temps de cerveau disponible » pour reprendre l’aveu de Patrick Lelay, ancien pdg de TF1. Le but n’est pas de gagner de l’argent avec la vente du média, mais de garder la maîtrise du temps de cerveau dont il est question. On peut alors placer du Coca Cola entre les lobes droit et gauche, tout en poursuivant la manœuvre bien au-delà. Cette fois on glisse dans la fente de l’esprit vide une information lisse et normative, désincarnée, lobotomique. Le prototype de cette machine a, justement été mis au point et réalisé en France par TF1, l’ex chaîne publique privatisée sous François Mitterrand.
Comme ceux de ses patients, la curiosité à donc quitté le cerveau des journalistes, et le regard est mort. Les universités et écoles des métiers de l’information, à bac plus 6, ne forment plus des journalistes mais des « techniciens de l’information », des petits soldats, des chiens de garde. Par leur recrutement endogamique, par l’enrôlement systématique d’étudiants issus des classes sociales les plus privilégiées, ces écoles ne sont qu’une machine à dégager « du temps de cerveau ». Dans les écoles, les universités, on n’apprend plus l’art de la critique, de l’analyse ou les affres du doute mais la bonne façon de manier comme il le faut l’argument définitif qui est l’explication « journalistique » de ce qui se passe dans le monde. Une arme, un argument pseudo scientifique dont l’unique but est de faire accepter, comme une fatalité, l’accroissement des inégalités sociales. La presse n’est plus la presse, elle est du lexomil. Et le rêve de ces petits soldats de la presse d’aujourd’hui est, au plus vite, de devenir rédacteur en chef et si possible directeur. Un désir bien partagé d’ascension, j’allais dire d’ascenseur qui encourage la stratégie personnelle et la connivence, jamais le courage pourtant nécessaire à ce métier, forcément difficile et polémique.
Dans les médias, pour un journaliste rebelle, ce qui devrait être un pléonasme, la survie est désormais impossible. Pour être juste la paupérisation de la presse, qui découle elle-même de la médiocrité de sa production. Et que le peuple incrédule n’achète plus… Donc cette paupérisation aide aussi à faire régner l’ordre du bien dans des rédactions où il est courant de gagner moins que le smic tout en étant titulaire d’une carte de presse.
Restent au pouvoir, à la tête des journaux, des idéologues corrompus. Aujourd’hui nommés ou adoubés par le pouvoir. L’ORTF du générale De Gaulle est mort, mais un autre Office, invisible, celui de la connivence lui a succédé au cœur de rédactions consanguines. Jadis, les journalistes français étaient fiers de reprendre la maxime de leurs confrères américains, notre travail était alors « d’affliger les puissants et de réconforter les misérables »… Il y a 20 ans, à la sortie du Centre de Formation des Journalistes, le rêve de 80% des diplômés était, « d’aller en reportage, d’aller courir le monde ». Il est maintenant, dans la même proportion, de « présenter un journal télévisé ». Surtout ne t’éloigne pas du bureau, de ce sanhédrin où les promotions se décident.
D’ailleurs pourquoi voyager. C’est à Paris que l’on décide combien d’hommes et de femmes sont morts au Kosovo. Pas à Pristina ou au Champ du merle. Et si le rédacteur en chef du Monde, par exemple, imprime à sa « une » un chiffre de 100 000 victimes, si vous, sur le terrain n’en comptez 1800, votre papier est inutile pour le journal et pré judicieux pour la suite de votre carrière. De toute façon, dans les mémoires, le vrai restera le bilan imprimé à la « une » du grand quotidien du soir. Après avoir vécu un tel épisode, un « reporter » comprend vite qu’il ne voyage que pour justifier les options idéologiques de son patron. Et quand il va repartir en guerre, au prochain choc de la planète, cette fois, il trouvera sur le terrain tous les cadavres dont rêve son directeur.
Après quelques jours en Mai 68, ce n’est que sur Internet que j’ai à nouveau rencontré la « liberté grande », comme l’écrivait Gracq. Elle y est si totale qu’elle peut faire peur. Au début, quand on écrit sur la Toile on se sent un peu comme ces faisans de batterie que les « viendars » tentent de lâcher les jours de chasse ; et qui préfèrent rester dans les cages. Je le répète, cela démontre que la liberté est bien un sport de combat qui exige un exercice constant. Faute de quoi elle s’ankylose. Pourtant si Internet reste encore un espace de liberté, Internet est menacé. Avec un décalage, les maîtres du monde et de la pensée s’aperçoivent enfin que cet univers d’anarchique échappe à leur contrôle. Dans un premier temps, au prétexte louable de chasse aux pédophiles ou aux terroristes, on vous espionne. C’est la première phase. Puis vient le complexe de la technique, celui du fonctionnement des moteurs de recherche, du référencement qui est entre les mains de trusts qui sont des colosses.
L’ultime étape, le coup de grâce va venir, la constitution de grands groupes de presse, sortes de TF1 du réseau, qui viendront monopoliser le maximum de temps de lecture, ou de vision, sur le net. Pour reprendre sur la Toile ce qu’ils auront perdu dans leurs écrans de télé. Ces oligarques ne laisseront plus le champ de la liberté qu’à quelques énergumènes, des peaux rouges sans moyens et sans audience, comme dernier alibis de la liberté. Ainsi George Orwell aura eu raison : un œil unique gouvernera le monde.

