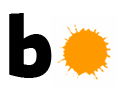



Difficile d’avoir un avis tranché sur le premier film de l’Américain Tom Ford. Styliste pour Gucci puis pour Yves Saint-Laurent, inventeur du porno chic, ce réalisateur n’échappe pas à sa condition de créateur de mode passé des podiums au cinéma. Mêmes projecteurs diffusant des sunlights artificiels, mêmes objectifs devant lesquels il prend la pose, ce n’est jamais que cet univers érotico-chic, sentimental’eau-choc qui nous est à nouveau proposé mais en vingt-quatre images secondes, comme si l’on tournait les pages de Vogue Homme trop vite et qu’elles s’animaient soudain.
Colin Firth, qui ne décroche pas de l’écran une seconde, est George Falconer, prof de littérature à la dérive depuis le décès de son amant dans un accident de voiture quelques mois plus tôt. Son existence lui est devenue insupportable et il décide d’en finir.
Adaptation d’un roman de Christopher Isherwood, A Single Man possède tous les défauts d’un premier film, celui de trop ressembler à son auteur, celui de vouloir trop en dire de lui-même, comme s’il n’était pas certain d’en faire un second. Force est de reconnaître cependant que ce maniérisme léché, cette affectation de papier glacé, font du film un objet curieux, différent, singulier. Pour autant, il n’est pas interdit de s’ennuyer au bout d’une demi-heure. Car ce parti pris esthétique finit vite par se mordre la queue, par ne mener nulle part et par ne rien dire de vraiment original par rapport à l’histoire de ce compte à rebours.
Créateur d’une mode vintage, resucée en puissance des années cinquante et soixante, Tom Ford est définitivement et malheureusement l’homme du passé, quand Saint-Laurent incarnait la modernité et l’intemporalité. D’ailleurs, le couturier français n’a jamais adoubé son successeur. Pour preuve, aucun cliché n’échappe à sa mise en scène : un Colin Firth au physique décalqué sur Yves Saint-Laurent, une Brigitte Bardot, un James Dean, l’affiche de Psychose pour la référence cinématographique, l’utilisation paresseuse de la bi-chromie entre les images grises du présent et les images en technicolor du passé, la femme sans homme, nymphomane, alcoolique et instable, la femme mariée, soumise, proprette, gentille et douce. Tellement so much sixties que Tom Ford aimerait nous faire croire qu’en 1962 en Californie, on écoutait déjà Serge Gainsbourg. Un anachronisme mal venu qui renforce ce sentiment de factice envahissant la pellicule, paralysant l’émotion. Lorgnant jusqu’à loucher sur la plastique d’A l’Est d’Eden, A Single Man s’enlise dans une mise en scène léthargique, stéréotypée alors que les films d’Elia Kazan respiraient la vie.
Pour autant ce n’est pas raté. C’est juste ennuyeux, peu profond alors que tout est mis en oeuvre pour nous convaincre du contraire. Deux résurgences philosophiques qui apparaissent de temps à autre pour la caution intellectuelle : le thème de la transparence, illustré par une maison aux murs de verre, en rapport avec l’"invisibilité" de l’homosexualité à cette époque et la conclusion révolutionnaire que vivre dans le passé empêche définitivement d’apprécier le présent.
Précision d’importance, le principal intérêt du film, si l’on excepte la curiosité de sa forme, réside dans le choix et le jeu des acteurs. Indéniablement, l’émotion parvient à surnager grâce à la composition de Colin Firth, tout en intériorité, en (presque trop) de retenue. Julianne Moore pétille de sensualité. Quant à Nicolas Hoult, qui incarne l’élève aguicheur de Falconer, il capte l’oeil énamouré de Tom Ford.

