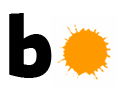




Je lis dans un quotidien barbichu que "le plan de sauvetage américain" qui ravit les bourses mondiales se présente sous la forme d’une enveloppe d’un montant compris entre "mille" et "deux mille milliards de dollars" - fourchette large (floue même, pourrait-on estimer, si on doutait que le marché fût transparent).
C’est toujours ça, n’est-ce pas, que les pauvres n’auront pas (et je comprends dès lors que le trader se fasse tumescent).
Quand tu crèves de faim dans les encoignures de New York City, USA, ou de Paris, France, jamais on ne te fait le moindre plan de sauvetage - on te montre plutôt que si que t’en es là, en faillite et mendiant comme un cauteleux bâtard une hypothétique pitance, ben c’est pour la (simple) raison que t’as laissé passer le train de la mondialisation heureuse, et où t’étais, bordel de merde, quand la dame est venue te prévenir que ta flexibilité donnait à désirer ?
On ne va certainement pas te filer mille milliards de dollars, ou deux mille, tout aussi bien, pour te sortir de ta misère - ça serait du socialisme, et nous, regarde-nous : y a pas marqué Hugo Chavez.
Noutre, et plus directement, on te signifie aussi que de toutes les façons : "Qu’est-ce que vous attendez de moi, que j’vide des caisses qui sont déjà vides ?"
(Mâme Dupont ?)
En résumé, si tu es l’un de ces SDF qui nous abîment le caniveau, le mieux est que tu comprennes que cet hiver tu vas crever - alors que si tu es un Lehman brother, tu peux tranquillement continuer à faire des confettis avec des billets verts : on trouvera toujours de quoi te réparer.
Naturellement : tout ça est à présent un peu fragile.
Maintenant que tout le monde a pu vérifier que le capitalisme est l’arnaque du millénaire, où les caisses prétendument vides soudain se remplissent quand il s’agit d’organiser le sauvetage des pansus porcs de la finance : la gueusaille risque de s’imaginer, plus fort qu’hier, qu’un autre monde est possible - et que les marchés ne sont pas l’universelle panacée que disent nos journaleux.
Malédiction : la "crise" mondiale née de l’âpreté au gain d’une minorité possédante et son règlement par le déblocage de mille à deux mille milliards de dollars pourraient agacer le populo.
Il faut alors calmer la tempête sous les crânes - et c’est là que Philippe Manière intervient.
Le gars est une espèce de Laurent Joffrin décomplexé (avec moins de poils au menton) : l’un de ces fidèles servants de la messe libérale qui depuis des temps immémoriaux vont klaxonnant que le marché, ami(e), est ton ami(e), ami(e).
Dans Marianne, ce matin, il revient sur la crise de ces derniers jours, et il en tire la seule conclusion possible, à son avis - et cette conclusion, assieds-toi, est que : "L’économie de marché, (…) ça marche du feu de Dieu".
Et je suis d’accord avec toi : c’est assez audacieux - mais comme je te disais, le mec n’est pas (du tout) là pour t’ancrer dans la vraie vie, mais bien plutôt pour te saturer le cervelas de son opium de marché.
Philippe Manière est un missionnaire de la foi boursière, exactement comme il y en eut (et comme il y a en encore) de la très sainte croyance qu’un Dieu gentil veille sur nous, et nous tient en vive sympathie.
Ainsi, de la même façon que ton curé t’annonce qu’il y a un Paradis après la vie, où ceux qui n’ont rien ici-bas auront une place de choix près de ce Dieu miséricordieux (heureux les crevards qui ne bouclent pas leurs fins de mois, sitôt morts ils vont se gaver), Philippe Manière te promet que le capitalisme, pourvu que tu saches te montrer assez patient, "débouche (…) à long terme, sur une extraordinaire amélioration de notre condition collective" [1].
Long comment, le terme ?
Long, éventuellement, comme plusieurs vies (passées au rude labeur où ton patron se tisse un golden parachute) : "Les bienfaits de l’économie de marché sont massifs - qu’on mesure le progrès accompli en trois cents ans, ou même en cinquante ans !"
L’important, n’est-ce pas, est en somme de bien mesurer, à l’été (chaud) de l’an de grâce 1608, que l’économie de marché prodiguera de larges bienfaits (aux big bosses de chez Lehman) au mois de septembre 2008 - et, par voie de conséquence, que nos smicards du jour peuvent tout de même caresser l’espoir d’une amélioration de leur niveau de vie dès le début de l’automne 2308, reconnaissons que c’est motivant.
Dès lors, et de la même façon que le catholique t’enjoint de souffrir en silence une vie certes chiche, mais pleine de la promesse d’un ailleurs délicieux, Philippe Manière peut énoncer (avec beaucoup de l’audace qui fait de nos journaleux économiques une catégorie à part au pays des sermonnaires hallucinés) que, oui, certes, la crise peut faire douter brièvement de la justesse du credo néolibéral, mais que surtout elle ne doit pas t’empêcher d’y croire aveuglément - et qu’il ne faudrait pas non plus que tu en retires l’exigence d’une surveillance trop accrue de la finance, car : "La régulation, elle aussi, est risquée".
(Puis, n’est-ce pas : il serait en effet assez con de trop s’emmerder avec "de nouvelles réglementations comptables et prudentielles très vertueuses", maintenant qu’on sait qu’il y aura toujours une banque centrale ou fédérale pour voler au secours de la possédance à grands coups de milliers de milliards de dollars.)
En résumé : de la même façon que la misère du monde n’est aucunement la preuve que Dieu est un conte pour opiomane crétin, la crise de ces derniers jours ne doit pas - ne doit surtout pas - remettre en cause le sacro-saint dogme concurrentiel des libéraux qui étendent sur nos vies leur emprise.
Fume : c’est du Lehman brothers.


[1] Staline, quant à lui, promettait le même débouché, pour le socialisme soviétique.